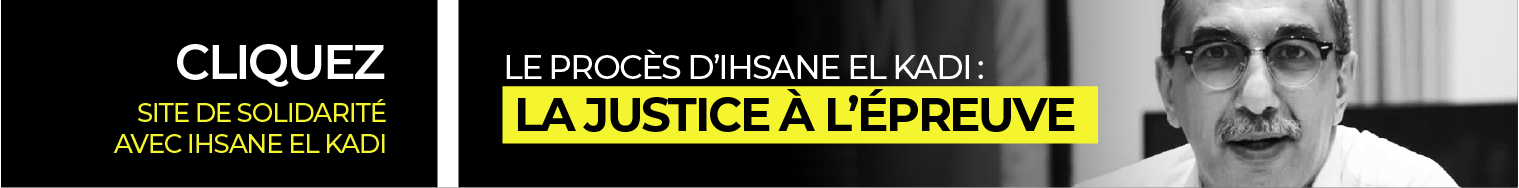Tripoli “ligne rouge” à ne pas franchir, le raid contre l’école militaire “un acte criminel, voire un crime de guerre”. Qui a commis le massacre contre les cadets libyens et menace Tripoli? Les forces de Khalifa Haftar. Alger affiche clairement sa défiance à celui qui bénéficie le plus des ingérences étrangères en Libye.
La visite à Alger du président du gouvernement d’union nationale libyen (GNA), reconnu par la communauté internationale, M. Fayez El-Serraj, été l’occasion pour Alger d’afficher, comme jamais auparavant, sa défiance à l’égard des actions du général Khalifa Haftar et, implicitement, des pays qui le soutiennent parmi lesquels l’Egypte, les Emirats, l’Arabie saoudite. Mais également la France, la Russie et les Etats-Unis qui voient dans le général Haftar, un élément “stabilisateur” contre les islamistes. L’intervention turque, entamée selon Erdogan, vient ajouter un ingrédient supplémentaire à la complexité libyenne. Le but immédiat de la Turquie est d’éviter que Tripoli ne tombe entre les mains du général Khalifa Haftar.
Face à ces interventions multiples, l’Algérie, dont l’action diplomatique et autre en Libye, a été bridée par la paralysie du système politique sous le règne d’un Bouteflika malade, rappelle la position de “principe” de “non-ingérence dans les affaires internes des Etats” et la défense de l’unité territoriale libyenne”. Il reste que ce rappel du principe de non-ingérence ne peut occulter la réalité multiforme et avérée des interventions étrangères au profit surtout du général Khalifa Haftar.

Une position défensive sur le dossier libyen
Le principe de non-ingérence s, dans le cas d’un conflit majeur se déroulant dans un pays avec lequel l’Algérie a une frontière de près de 1000 km, s’avère surtout comme une forme d’auto-limitation alors que les acteurs locaux libyens sont pratiquement des alliés voire des supplétifs de puissances extérieures.
L’Algérie a été depuis 2011, avec l’intervention de l’OTAN en Libye, dans une position purement défensive pour ne pas dire spectatrice. Un effet évident de la paralysie du régime Bouteflika en dépit des affirmations de “principe” qui servent surtout de justification à un profil bas alors que même des petits États – même s’ils sont riches – interfèrent directement et puissamment en Libye. Même si l’Algérie n’est pas menacée militairement par le camp du général Haftar – dont les soutiens extérieurs sont aussi nombreux que divers -, son éventuelle victoire contre le gouvernement Al-Serradj menace clairement les intérêts de l’Algérie. D’où l’insistance sur “la nécessité « de trouver une solution politique” qui garantit “l’unité de la Libye, de son peuple et de son territoire ainsi que sa souveraineté nationale, loin de toute ingérence étrangère”.
La Turquie, une allié “tacite”?
Certains s’étonnent -le plus souvent par une motivation anti-islamiste a sens unique qui oublie ou feint d’oublier que les salafistes madkhali liés à l’Arabie saoudite sont alliés au général Haftar- que l’Algérie ne condamne pas ouvertement l’action de la Turquie en Libye.
En réalité, le ministre des affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a assuré le service de principe en déclarant que “l’’Algérie n’accepte aucune présence étrangère sur le sol du pays voisin et cela quel que soit le pays qui veut intervenir… La langue de l’artillerie ne peut être la solution. Cette dernière réside dans un dialogue sérieux entre les belligérants avec l’aide des pays voisins, notamment l’Algérie… La démarche turque qui vise à déployer des troupes sur le sol libyen internationalise la crise de fait et met l’Algérie devant le fait accompli”.
Dans les faits, l’internationalisation de la crise libyenne ne date pas de la décision turque. Formellement, l’arrivée de troupes troupes turques se fait sous le sceau de la légalité contrairement aux acteurs étrangers – dont les mercenaires russes de la force Wagner – agissant dans le camp de Khalifa Haftar.
Pourquoi l’Algérie s’insurgerait-elle trop franchement contre la Turquie et pas contre les autres États qui appuient directement Haftar? L’intervention turque qui vise surtout à empêcher Haftar de prendre Tripoli et d’en finir avec le Gouvernement d’union nationale libyen (GNA) ne dessert pas les intérêts immédiats de l’Algérie. La chute du GNA est un très mauvais scénario car il dispense les “vainqueurs” de négocier sans pour autant assurer une sécurisation de la Libye. D’une certaine manière – et même si Alger ne le reconnaîtra jamais – l’intervention turque compense l’auto-limitation de l’Algérie.
Marteler le principe de « non-ingérence » ne suffit pas
L’affaire libyenne est le reflet depuis 2011 d’un affaiblissement du poids international de l’Algérie du fait de l’état d’impotence manifeste du régime durant les deux derniers mandats de Bouteflika. Elle est aussi un échec du renseignement qui n’a pas vu venir la chute de Kadhafi qui fait que l’Algérie s’est retrouvé démunie de liens et de réseaux dans la “nouvelle Libye” qui n’arrive pas à naître. Est-ce un hasard que l’Allemagne ait oublié, dans un premier temps, d’inviter l’Algérie à la Conférence de Berlin sur la Libye alors que l’Egypte, les Emirats, la Turquie – ainsi les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne et l’Italie – y étaient conviés? Une énormité longue de près de 1000 km que le président turc Erdogan a dénoncée en estimant que l’Algérie et la Tunisie devaient être de la partie. La chancelière allemande, Angela Merkel, a officiellement corrigé sa copie concernant l’Algérie en invitant Abdelmadjid Tebboune à la Conférence. Mais il est évident que marteler le principe de “non-ingérence” alors que les ingérences sont ouvertes en Libye ne suffit pas.