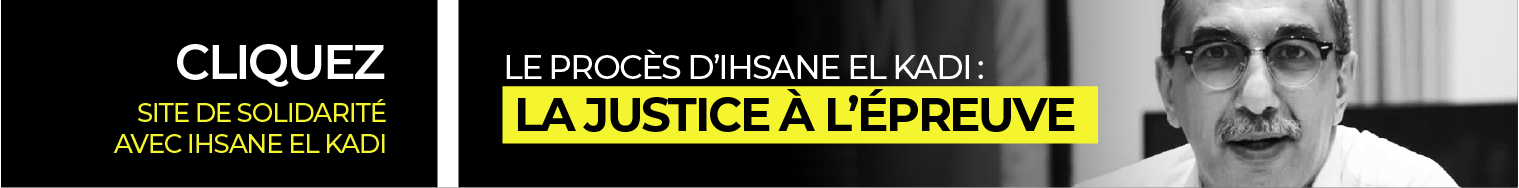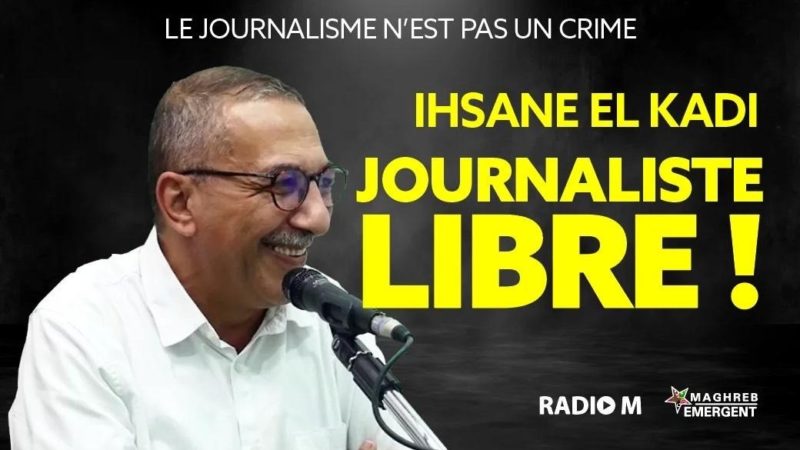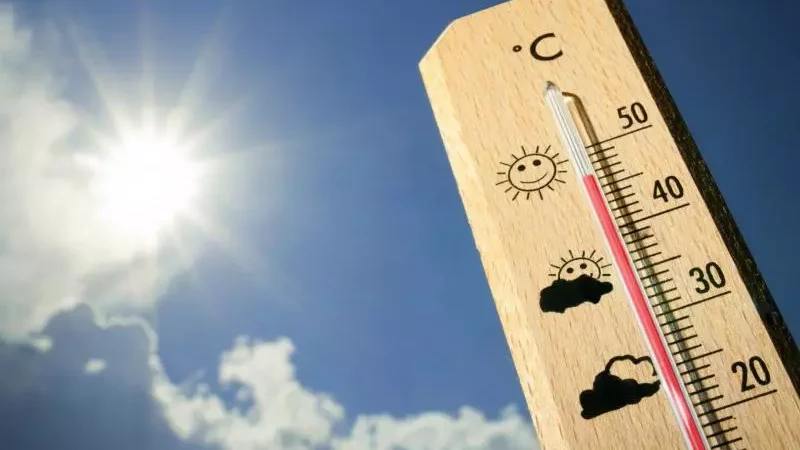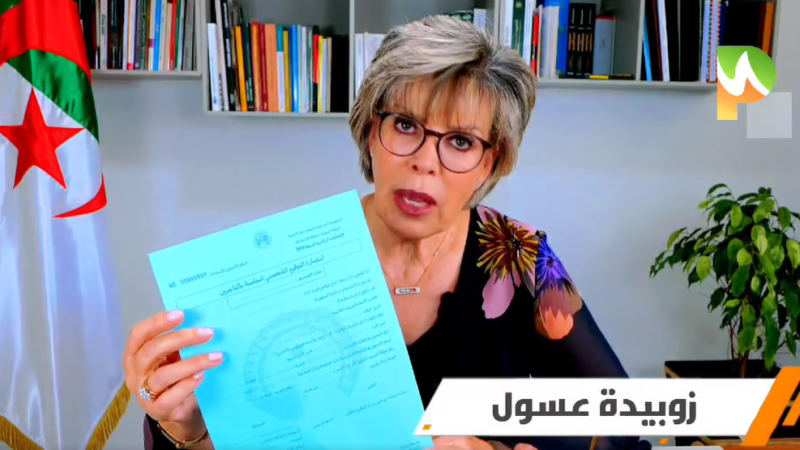Le littoral de l’Algérie est réputé pour la diversité de ses sites et leur beauté. Cependant, leur mise en valeur et leur exploitation sous l’angle touristique et culturel demeurent bien en-deçà de ce que mérite ce potentiel naturel.
Il faut ainsi savoir que de nombreux sites jalonnant le littoral algérien demeurent encore à l’état naturel, pour ne pas dire en jachère ; mais qu’ils peuvent, avec un peu de bon sens et surtout beaucoup de volonté, faire l’objet d’une valorisation conséquente. Il s’agit, en l’occurrence, de faire connaitre ces lieux dits et pour en faire quoi ? Des lieux de mémoire, bien évidemment. Répertoriés de surcroit. Tout cela n’est pas vain dans la mesure où la mer a toujours joué un rôle essentiel dans l’histoire de l’Algérie et ce, depuis l’Antiquité. Les invasions mais aussi les apports civilisation els ont utilisé l’espace maritime comme support privilégié. Il va sans dire, à ce titre, que de nombreux vestiges archéologiques attestent de cette réalité. Au plan des expressions artistiques, de nombreuses œuvres permettent en effet de rendre compte de l’influence de cette présence.
Mais de nombreux lieux dits «vierges» qui sont -ou peuvent devenir- autant de lieux de mémoire existent aussi. Hormis les plus en vue tant pour les Algériens que pour la communauté internationale, il en est ainsi, innombrables, qui jalonnent le littoral, présentant différents statuts ; bien entendu selon qu’ils aient jusque-là été ou non traités sous l’angle culturel et historique, et qui néanmoins constituent une source inépuisable en matière de tourisme culturel local. Sous cet angle, il nous vient aussitôt à l’esprit, en autres remémorations, cette extraordinaire anecdote rapportée il y a plus de deux mille ans par un historien latin, Pline le jeune, à propos d’un site connu de tous puisqu’il s’agit de la baie de Chettaibi, à quelques kilomètres à peine à l’ouest de la ville d’Annaba. Retour donc, sur le contexte de l’époque et de l’anecdote en question : Il faut d’abord savoir qu’aussi loin qu’on remonte le temps, des dauphins ont toujours vécu dans ce site et y vivent toujours, non loin de la cote. Très souvent donc, notamment durant la saison estivale, ces cétacés se rapprochent de la plage pour, tenez-vous bien, s’amuser avec les enfants qui viennent faire trempette dans la mer toute proche.
Valoriser de façon appropriée les lieux dits à travers le littoral
Toujours pratiquement au même endroit, c’est-à-dire à quelques encablures à peine de Chettaibi, mais en remontant quelques siècles plus tôt, les mêmes scènes d’amitié entre les cétacés et l’homme ont été observées et rapportées dans des relations de voyages, par des visiteurs et simples voyageurs. Ainsi, à la plage Fellah Rachid (ex. Saint Cloud-Annaba), c’est le fameux «dauphin d’Hippone» qui, selon le même historien latin Pline le jeune, a sauvé un garçon de la noyade il y a de cela plus de … 2000 ans ! On retiendra que l’enfant de la ville et le dauphin devinrent par la suite amis, et le tout Hippone se pressait alors sur le rivage pour voir ces deux compagnons l’un sur le dos de l’autre, jouant, plongeant et sautant. Etrange similitude donc, entre cette histoire d’il y a plus de 2000 ans et celle observée par les visiteurs actuels. Des enfants et des dauphins qui se prêtent volontiers à des jeux qui ne peuvent se concevoir qu’entre… amis.
Alors pourquoi ne pas «immortaliser» le site en question et ce, en y érigeant une belle sculpture -normée- représentant un enfant chevauchant un dauphin en mouvement. Avec, incrustée dans le socle, l’anecdote concernant ces deux amis rapportée par Pline le Jeune. Et aussi, pourquoi pas, un delphinarium sur place à l’image de celui de Béni Saf, histoire de témoigner de ce qui s’est passé en ce lieu et, par la même, montrer que si ce site est chargé d’histoire, c’est quelque part grâce aux dauphins qui sont toujours là pour attester de l’exceptionnelle originalité des lieux.
Pour tout dire, il ne serait pas inutile, bien au contraire, de se consacrer à l’investigation de toutes les autres représentations culturelles de la mer égrenées tout au long du littoral algérien, autrement dit d’Est en Ouest ou inversement, notamment pour valoriser -de façon appropriée- non seulement les monuments historiques et/ou naturels existants, mais aussi les lieux dits qui leur sont liés, jusque-là demeurés vierges sous cet angle. Les plus grands bénéficiaires seraient assurément les APC locales et leurs habitants, ne serait-ce que par les recettes touristiques que le nombre de visiteurs et touristes génèreraient dans ces lieux de mémoire originaux à plus d’un titre.
Kamel Bouslama