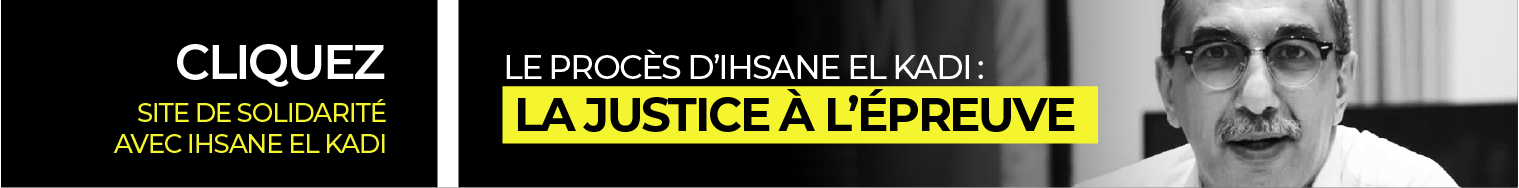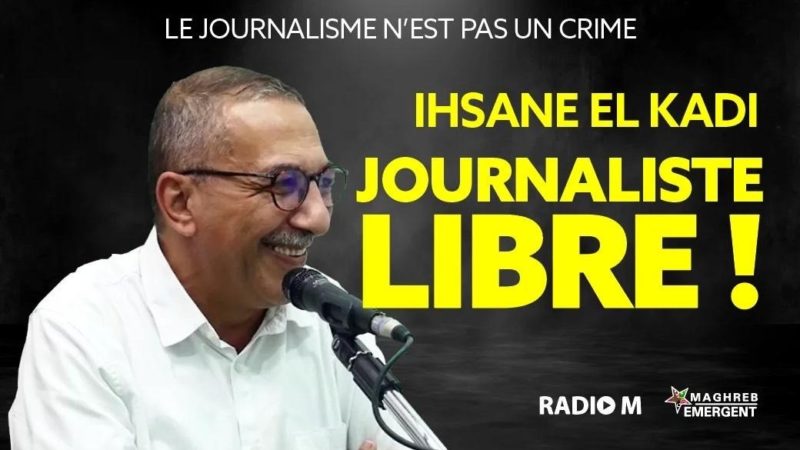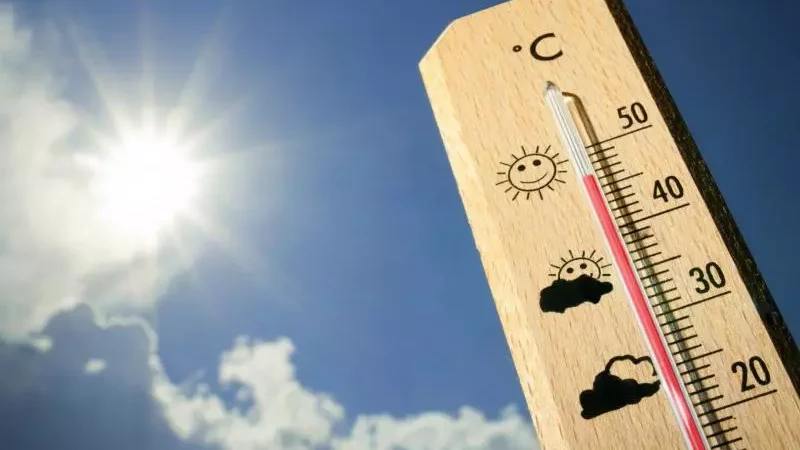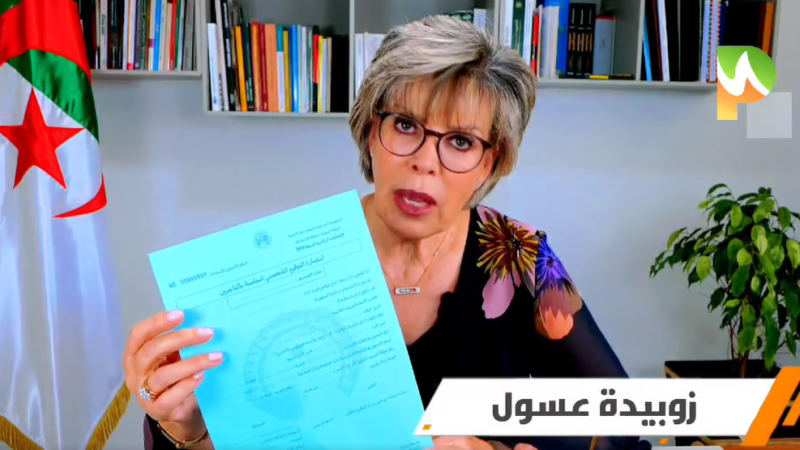La presse et les journalistes en Algérie traversent sans doute l’une des périodes les plus difficiles depuis l’ouverture démocratique en 1989. Des observateurs de la scène médiatique et des défenseurs des droits humains sont unanimes à relever que la répression et les entraves à l’exercice du métier ces trois dernières années ont atteint un seuil jamais connu par le passé.
Signe de cette difficile situation: plusieurs journalistes ont été emprisonnés et lourdement condamnés depuis 2020. Derniers en date: les journalistes, Ihsane El Kadi, directeur du pôle éditorial de « Maghreb Emergent » et « Radio M » et Mustaha Bendjamaa, rédacteur en chef du « Provincial ».
Poursuivi pour un supposé « financement étranger de son entreprise » Interface Médias (IM), Ihsane El Kadi a été condamné le 2 avril dernier à cinq années de prison, dont trois ferme, par le tribunal de Sidi M’Hamed à Alger. Le même tribunal a prononcé la dissolution de la société IM, éditrice des deux médias Maghreb Emergent et Radio M, la confiscation de tous ses biens saisis, et 10 millions de dinars d’amende contre l’entreprise.
En détention provisoire, le jeune journaliste du journal local, « Le Provincial », Mustapha Bendjamaa est poursuivi dans deux dossiers différents avec de lourds chefs d’inculpations. Dans le premier, il est accusé d’un présumé financement étranger et dans le second en lien avec l’ »affaire » de la militante, Amira Bouraoui. Dans ce dernier, il est co-accusé avec plusieurs personnes d’ « association de malfaiteurs dans le but d’exécuter le crime d’immigration clandestine dans le cadre d’une organisation criminelle ».
Ces deux noms allongent la longue liste des journalistes emprisonnés et condamnés depuis 2020. Arrêté en mars 2020 pour avoir couvert une manifestation du Hirak, Khaled Derarni, aujourd’hui représentant de l’ONG, RSF en Afrique du Nord, a été condamné à 3 ans de prison ferme en première instance, avant de quitter la prison au terme de 11 mois de détention.
Il y a aussi, le journaliste Sofiane Merakchi, emprisonné et condamné à 8 mois de prison ferme le 5 avril 2020. Ancien correspondant du quotidien Liberté à Tamanrasset, Rabah Kareche a lui aussi été emprisonné pour un article de presse sur le découpage administratif au sud algérien. Il a été condamné à un an de prison, dont 8 mois ferme. Rabah Kareche a été libéré de la prison de Tamanrasset après 6 mois de détention suite à une réduction de sa peine en appel.
Le 8 septembre 2022, Belkacem Houam, journaliste à Echorouk est placé en détention à la suite d’un article de presse relatif au renvoi par la France de dattes algériennes qui contiendraient un pesticide non autorisé par l’Union européenne.
Quelques semaines plus tard, le 18 octobre 2022, le journaliste de Liberté, Mohamed Mouloudj est condamné à deux ans de prison, dont un ferme, après 13 mois de détention provisoire. Le journaliste est accusé d’appartenance au MAK (mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie), une organisation classée terroriste par les autorités algériennes.
Outre ces emprisonnements, plusieurs journalistes font l’objet de poursuites et placés sous contrôle judiciaire. C’est le cas, notamment, des journalistes, Jamila Loukil et Saïd Boudour, membres de la Ligue algérienne des droits de l’homme, victimes d’un acharnement judiciaire sans fin depuis 2021. Ils sont poursuivis pour « appartenance à une organisation terroriste » et leur affaire est toujours en cours.
Arrêtée lors d’une couverture d’une marche du Hirak le 14 Mai 2021 à Alger, placée en garde à vue pendant cinq jours, la journaliste, Kenza Khatto, est relaxée en appel par la Cour de Ruisseau d’Alger fin 2021.
Cette vague d’arrestations et d’emprisonnements n’a pas touché seulement les journalistes traitant des sujets politiques. Les journalistes du quotidien arabophone Essawt El Akhar, Mohamed Laamari, Meriem Chorfi et Rafik Mouhoub ont eu à le vérifier à leur dépend. Ils ont, en effet, été placés sous contrôle judiciaire le 2 avril 2020 après que leur média a repris la veille en Une la déclaration d’un député concernant des faux-négatifs Covid-19.
Nadjet Benmessaoud et Karim Boughaba, deux journalistes à la radio locale d’El Taref, ont eux aussi été convoqués par la police suite à la diffusion d’un reportage sur un décès par manque d’oxygène à l’hôpital El Besbes.
Elle s’est aussi étendue aux médias puisqu’une véritable guerre, selon les observateurs, a été engagée contre ceux qui traitent des « sujets qui fâchent ». Ainsi, plusieurs sites d’information ont été bloqués depuis l’arrivée de Abdelmadjid Tebboune au pouvoir, confirmant l’option du verrouillage du paysage médiatique indépendant.
Entre autres sites d’information bloqués: Radio M et Maghreb Emergent, dont les locaux sont aussi scellés, Casbah Tribune, TSA, Twala, L’avant-garde, Interlignes, Algérie Part …
Par décision administrative, les deux chaînes privées, Lina TV et El Djazaïria One sont, par ailleurs, définitivement fermées à une semaine d’intervalle (16 et 23 août 2021).
Dans cette guerre menée par les autorités, la presse étrangère n’est pas épargnée non plus. Au lendemain des législatives du 12 juin 2021, l’Algérie retire l’accréditation à France 24 et ses collaborateurs, dont le journaliste, Moncef Ait Kaci, sont emprisonnés avant d’être relâchés.
Quelques semaines plus tard, c’est la chaine de télévision privée française M6 qui se voit signifier qu’elle n’était pas la bienvenue en Algérie après la diffusion d’un documentaire sur le mouvement de protestation populaire, le « Hirak ».
Loin d’être exhaustif, ce bilan est emblématique de la situation de la liberté de la presse et d’expression alors que nous célébrons la journée mondiale de la presse. Dans un contexte où la liberté de la presse est déjà fortement malmenée, les autorités algériennes viennent d’adopter une nouvelle loi sur l’information qui risque, aux yeux des observateurs, de réduire à néant l’exercice d’un métier, selon les canons universellement établis.