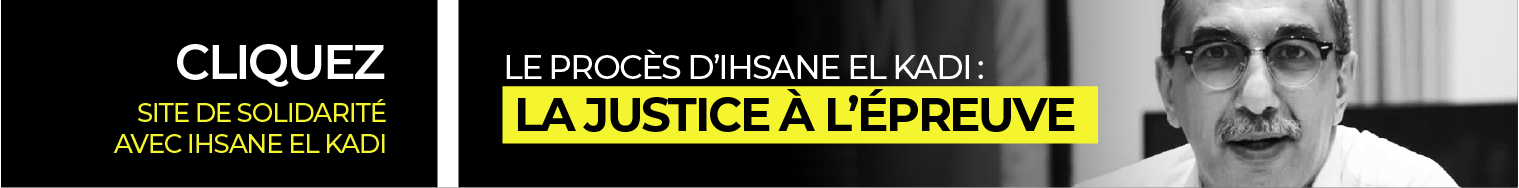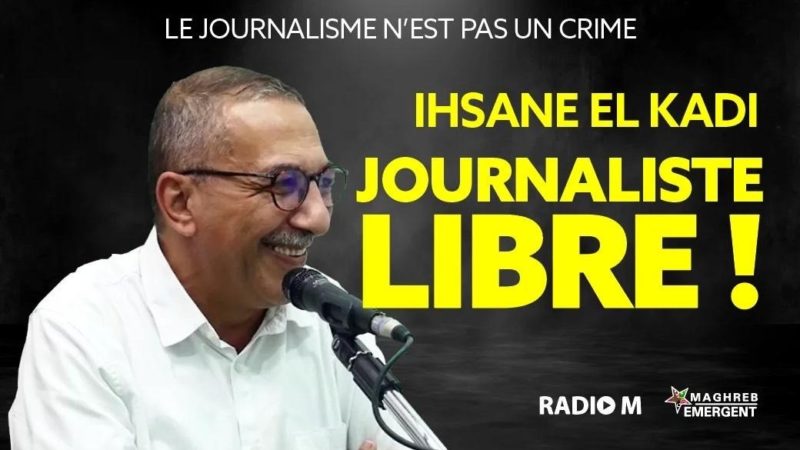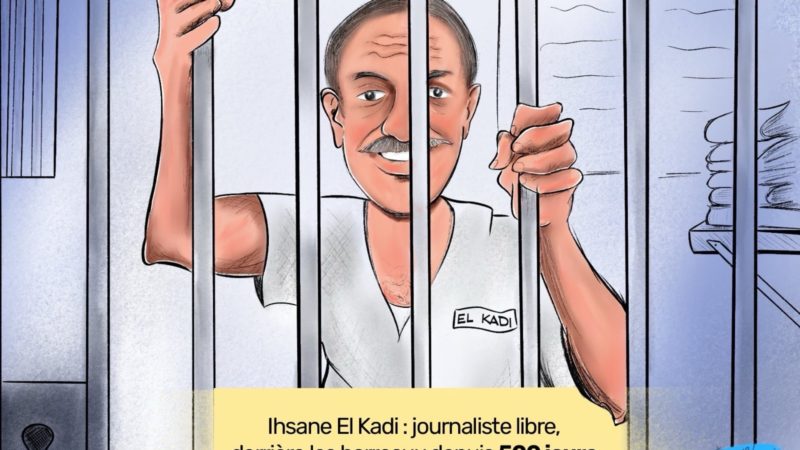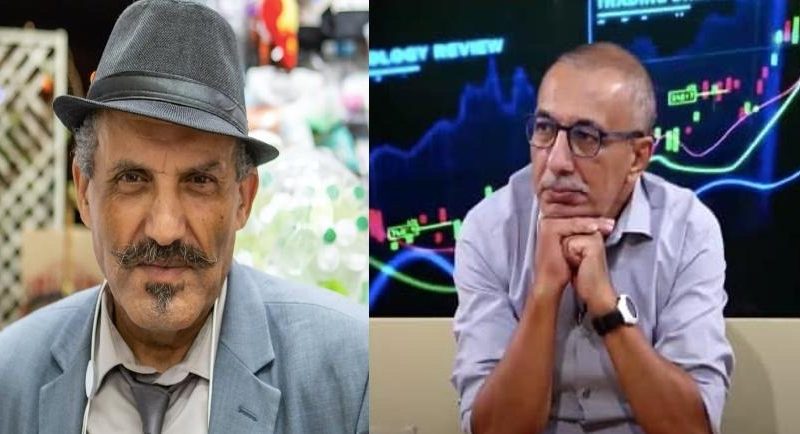En 1972, Kateb Yacine reconnaît lors d’un entretien : « Avec Nedjma, quand j’ai voulu camper le personnage, je me suis rendu compte à quel point nous ignorions tout de nos femmes, de nos propres sœurs. Et avec la mère, la rupture a lieu dès l’enfance. Ce monde des femmes reste une grande inconnue et il est temps de le mettre en lumière ». Il admettra également concernant l’une de ses pièces les plus féministes La Kahina ou Dihya : « Pour nous, il est difficile d’arriver à imaginer ce que peut être une femme, et une femme chef de tribu »
Dans notre pays, nous avons longtemps perdu le contact avec la réalité féminine. Nous avons perdu de vue leur vie quotidienne, leurs rêves et leurs ambitions, leurs désirs et leurs contradictions. Leurs différences également. Et Kateb Yacine nous rappelle combien la fiction peut jouer un rôle primordial dans le rétablissement d’une image nuancée et complexe des femmes algériennes. Nul mieux que la fiction permet de comprendre ce qu’être femme veut dire.
Si dans l’imaginaire collectif Omar Guetlato représente l’archétype d’une masculinité vulnérable et touchante, loin des représentations erronées du mâle dominant, macho et sûr de lui, aucun personnage féminin n’est parvenu à atteindre le même statut que le Omar mis en images, il y a maintenant plus de quarante ans par Merzak Allouach. Pourtant des personnages féminins fascinants, le cinéma algérien contemporain n’en manque pas. Il y a d’abord la fringante Leïla de Sid Ali Mazif dans Leïla et les autres (1977) et bien sûr la belle et vulnérable Nahla (1979) de Farouk Beloufa, certes libanaise mais est-ce si important? L’infatigable Lila de La Nouba des femmes du Mont Chenoua (1979) d’Assia Djebar. Il y a eu la courageuse Rachida (2003) de Yamina Bachir, l’intrépide Zina de Roma wa la n’touma (2006) de Tariq Teguia. L’intransigeante et facétieuse Rym dans Mascarades (2006) de Lyès Salem et probablement beaucoup d’autres.
Cela fait peu de femmes réalisatrices dans le lot me direz-vous et il est en effet vital d’encourager les femmes à investir le champ de la création. Mais ne nous ne nous y trompons pas non plus, il ne suffit pas d’être femme pour donner naissance à des personnages féminins intéressants et les hommes ne tombent pas systématiquement dans la simplification et l’objectification. S’il est nécessaire, l’acte de représenter n’est de toute façon jamais parfait. Il peut tour à tour sublimer, magnifier, réduire ou enfermer dans la caricature.
Je dois avouer par exemple que même si le film a le mérite d’aborder une période qui demeure taboue à l’écran, je n’adhère pas à la vision du monde que nous propose Mounia Meddour dans Papicha (2019). Pas une seule seconde je n’ai été convaincue par son personnage principal. Je ne pense pas qu’on puisse surmonter aussi vite l’assassinat de sa sœur, en dessinant frénétiquement des robes sur un carnet et en organisant un défilé de mode. Je ne me défais pas non plus d’un malaise persistant devant cette galerie de personnages masculins plus insipides et veules les uns que les autres. Je n’aime pas enfin que ceux qu’on appelle communément les terroristes soient représentés comme des monstres lointains et déshumanisés car cela dispense le spectateur de l’effort et de la nécessité de comprendre ce qui s’est passé pendant ces années-là.
Je préfère la manière dont Maïssa Bey sait écrire le choc et la stupeur devant la mort et la folie meurtrière des années 1990. Dans une nouvelle intitulée « Corps indicible » elle montre combien la violence rend tout discours impossible. La narratrice qui a été avec sa famille, victime des violences d’un groupe armé, s’exprime dans une langue saccadée, à travers des phrases incomplètes : « Tiens Louisa c’est le nom de ma mère. C’était. N’est plus là. N’est plus que cendres. Ou fumée. Cherche sa trace mais faut oublier ça aussi. Il a dit ça. Il faut oublier. Oublier ou. Rien n’a été. Exciser. Non, c’est pas ça. Exorciser il a dit. Extirper le mal. Il dit beaucoup de mots comme ça le docteur quand il vient. » Le traumatisme s’exprime jusqu’au lapsus qui lui fait confondre les verbes « exciser » et « exorciser ». Les souvenirs et les marques de la violence restent indélébiles.
Dans le documentaire de Hassen Ferhani, 143, rue du désert (2019), je suis très sensible au personnage de Malika dont la liberté me surprend et m’émeut. A plus de soixante ans, Malika tient son café sur la route qui relie Alger à Aïn Guezzam. Sa vie, Malika se l’est choisie, elle a décidé de composer son propre récit et d’écrire sa propre histoire et elle tord le cou à tous les clichés par sa seule présence à l’écran.
Je rêve parfois qu’on nous offre à nouveau un personnage féminin aussi fort et transgressif que la jeune Nadia de La Soif d’Assia Djebar. En 1957, ce personnage aux désirs naissants et ambivalents avait indigné la belle et grande famille nationaliste. Comment pouvait-on s’occuper de ce genre de fadaises, en pleine lutte pour l’indépendance ? Je ne peux m’empêcher de songer à tous les personnages qu’Assia Djebar a peut-être fait taire en elle, après la volée de critiques assassines dont elle a été l’objet, alors qu’elle n’avait que 21 ans.
Je ne me remets toujours pas de la modernité de Malek Haddad qui en 1960 donne la parole dans L’élève et la leçon à la jeune Fadhila qui demande à son père médecin, de la délivrer de la grossesse qu’elle porte parce que son compagnon et le futur père de l’enfant est un combattant du FLN, recherché par la police française.
J’aimerais qu’on honore enfin le travail de Habiba Djahnine qui depuis des années réalise des documentaires d’une grande puissance cinématographique et politique, qui œuvre sans relâche à dynamiser le cinéma documentaire algérien et qui donne à des jeunes réalisatrices l’opportunité de faire des films qui parlent d’elles et de leur communautés.
J’aimerai que les lumières des projecteurs n’éclipsent pas nos propres espoirs et premiers films et qu’on décerne nous-mêmes des prix à des actrices et réalisatrices comme Meriem Medjkane, Drifa Mezenner, Bahia Bencheikh-El-Fegoun Sonia At Qasi Kessi, Wiame Awres, Saadia Gacem, Kamila Ould Larbi, Leïla Saadna et Kahina Zina …et j’en oublie probablement beaucoup d’autres.
Plus nous aurons de personnages féminins dans nos romans, dans nos films et nos séries télé, plus nous pourrons produire une image complexe de la femme algérienne. Plus nous aurons de femmes créatrices, plus cette image s’enrichira de nuances et de vérités. Plus nous serons également à même de pointer sereinement les simplifications réductrices et nous réjouir de l’éclosion de représentations qui déconstruisent les clichés et changent le cours de l’histoire.