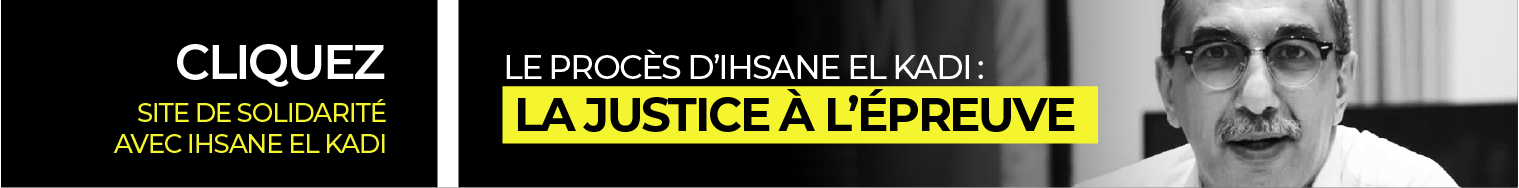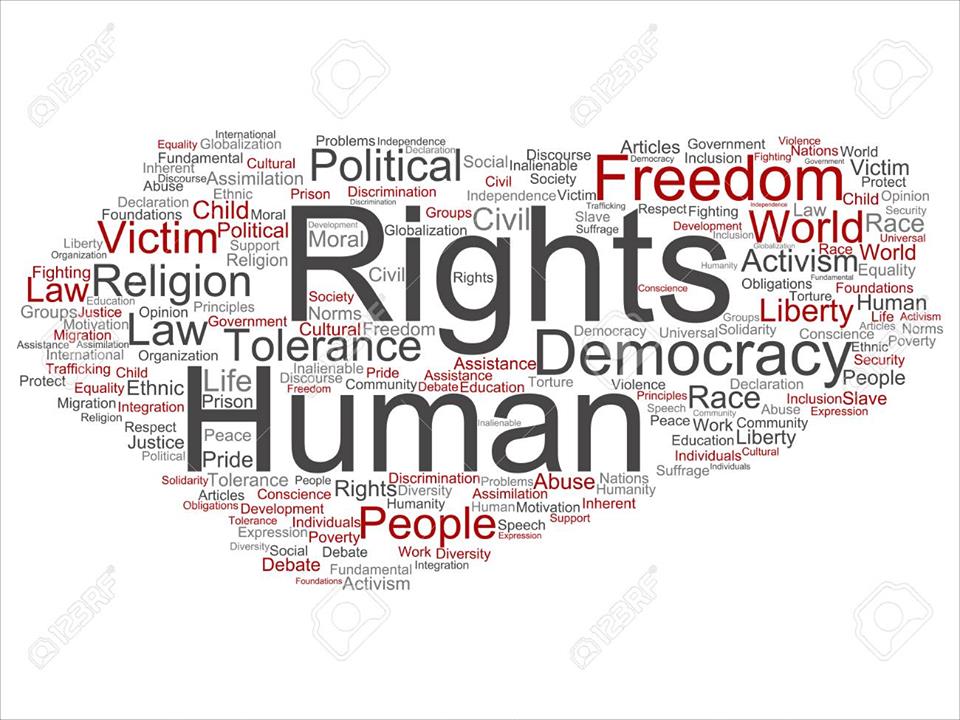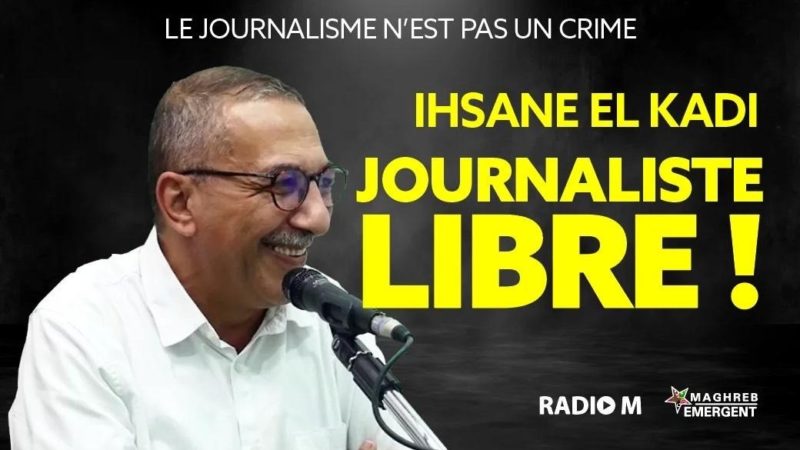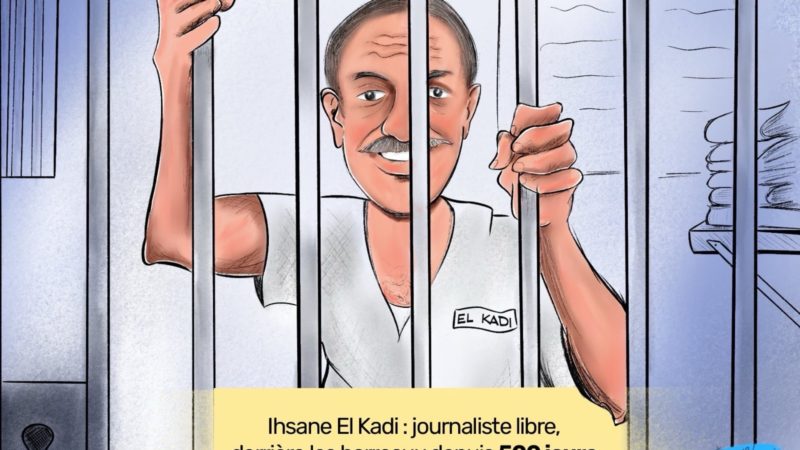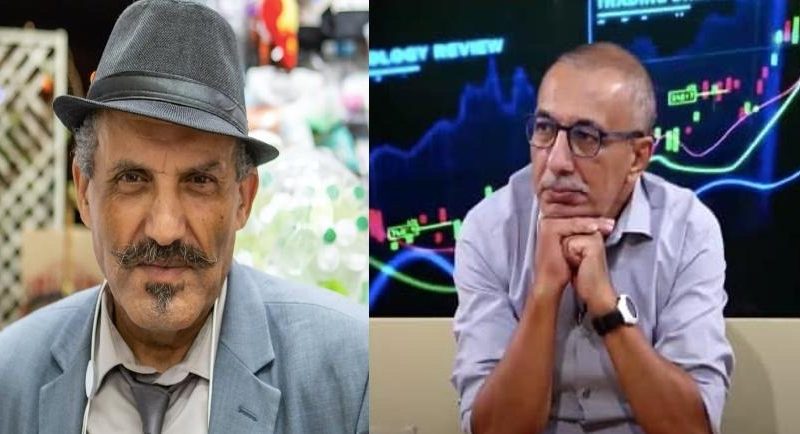Tous ceux qui depuis 1962, ils étaient peu nombreux, et par la suite au cours des années 80 ont prôné la laïcité ont constitué une véritable avant-garde des libertés. Il faut leur reconnaître la perspicacité et le courage politiques. Dans un contexte difficile, marqué par la montée de la religiosité et du mouvement islamiste intolérant, ils ont eu la lucidité de désigner la revendication que l’on ne peut durablement éluder parce qu’elle est partie constitutive des droits fondamentaux de la personne humaine.
Ils ont eu à affronter l’incompréhension et même l’hostilité de courants progressistes ou socialistes qui considéraient cette revendication comme une diversion avec le risque donné comme certain de s’isoler des larges courants populaires sous l’emprise des préjugés et de l’ignorance. L’éruption du Mouvement populaire du 22 Février 2019, le Hirak, qui veut mettre fin à l’Etat autoritaire et instaurer l’Etat de droit, place les libertés fondamentales au cœur des luttes actuelles.
Il est donc légitime de s’attarder sur la liberté religieuse et la laïcité. Précisons d’emblée le caractère universel de la laïcité. Dans la Constitution de nombreux pays, il n’est pas fait état de la notion de laïcité mais l’énoncé du principe est sans équivoque. Il en est ainsi de la Constitution américaine qui dans son premier amendement dispose : «Le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion,.. ». Si les émetteurs de l’idée de laïcité ont vu clair, la perception de cette notion n’a pas connu toute la clarté souhaitée. Les opposants à la laïcité ne se recrutent pas seulement parmi les milieux conservateurs ou extrémistes. Des milieux plus ouverts de la société civile affichent leur méfiance ou leur crainte. Peut-être imaginent-ils un État de droit avec une « religion d’État »? Ils ne peuvent qu’être invités à examiner le bilan de la gestion de la religion par l’État autoritaire.
Le serviteur zélé et médiocre de l’Islam
L’État autoritaire en place au cours de ces 58 années d’indépendance s’est accaparé la gestion de la religion. Par l’article 02 de la Constitution qui fait de l’Islam « la religion de l’État », il se considère seul habilité à orienter les activités religieuses. Disposant d’un important effectif d’imams et autres fonctionnaires, il encadre le culte sur toute l’étendue du territoire.
Il consacre une part relativement élevée du budget de l’État au financement des activités liées à la religion. La densité de mosquées dans le pays est très élevée. Sous des formes diverses, il subventionne le pèlerinage à la Mecque. Même l’école a été mise au service d’un enseignement religieux rétrograde. L’État a favorisé le développement de la religiosité dans la société.
Les pouvoirs successifs n’hésitent pas à utiliser les réseaux religieux constitués pour faire admettre leur politique. Longtemps considéré comme un garde-fou contre les forces démocratiques, l’instrumentalisation de la religion s’est cependant retournée contre le pouvoir lorsque les intégristes se sont emparés des mosquées.
C’est par la répression qu’il reprit le contrôle des mosquées même si la pression intégriste persiste. Dans l’ensemble, ce qui intéresse les pouvoirs, c’est la docilité et la servitude des citoyens. Parce que l’instrumentalisation de la religion favorise la propagation d’un état d’esprit d’allégeance, il continue à montrer que nul autre que l’État ne peut donner à l’Islam une image de prestige et de grandeur. La Grande Mosquée d’Alger, un gouffre financier, en est l’illustration.
A côté de cette volonté de paraitre un serviteur zélé de la religion, la gestion étatiste de la religion a abouti à une indigence intellectuelle notoire. Les rares théologiens ou esprits critiques susceptibles d’éclairer l’opinion soumise à l’ignorance et aux préjugés sont marginalisés ou contraints à faire valoir leur compétence ailleurs.
Aucune œuvre artistique, littéraire ou philosophique islamique digne d’être portée à la connaissance du monde n’est sortie de ce carcan religieux construit par les pouvoirs successifs. L’État s’est montré un serviteur médiocre et n’a nullement favorisé l’émergence d’une pensée religieuse novatrice. Il a mérité le titre de serviteur zélé et médiocre de l’Islam. C’est dans le prolongement cette médiocrité, qu’il a recouru à la répression des minorités religieuses ou aux entraves administratives pour les cultes naissants. Il a délibérément violé les libertés fondamentales contenues dans la Constitution. Il révèle des tendances totalitaires évidentes.
Libérer les minorités
Dans une première approche, la liberté religieuse consiste à respecter les droits des minorités religieuses ou laïques. On ne peut que qualifier de minorités tous les courants de pensée religieux ou pas qui ne s’inscrivent pas en Algérie dans le culte musulman sunnite malékite.
Pourquoi une majorité consistante craindrait-elle les minorités ? Surtout si ces minorités exercent leur culte ou leur libre pensée dans un cadre pacifique et sans chauvinisme et rivalité agressive. Ce que la loi permettra de définir. Le respect des minorités repose d’abord sur l’exigence de respect des droits fondamentaux de chaque citoyen, de chaque personne humaine qu’on ne peut soumettre à un ostracisme. Les Algériennes et les Algériens appartiennent à l’humanité et disposent en tant que tels de droits liés à la personne humaine. Il ne doit être du pouvoir d’aucun autre être humain, fût-il gouvernant, de les déposséder de ce qui fait leur dignité.
Le caractère inaliénable ou imprescriptible de ces droits interdit ce qui s’est développé depuis 1962, la répression et les harcèlements contre des Algériens qui ont exercé leur entendement, leur capacité à raisonner. « La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres » est un précepte universel, Il transcende les majorités comme les minorités car il délimite le droit de la personne humaine.
Les minorités, une source d’innovations
Dans une deuxième approche, il convient de comprendre le rôle des minorités dans l’équilibre global de la Société, intérêt de la majorité bien compris. Les moins jeunes se souviennent certainement des moqueries et railleries subies par la minorité d’Algériens, montrés du doigt pour leur modernité, qui avaient compris plus tôt que la majorité qu’il fallait faire sortir leurs filles du foyer et les scolariser.
La majorité a dû attendre de voir la réussite de la minorité pour l’imiter et généraliser ainsi ce qui apparait aujourd’hui comme une évidence. Cet exemple illustre bien comment les inventions, les innovations et les progrès sont toujours le fait de minorités. Ils sont par la suite généralisés quand la majorité se les approprie.
Il est donc de l’intérêt de toute la société de garantir la coexistence pacifique de majorités et de minorités, coexistence qui produit les avancées de toute la société. De combien d’innovations, de découvertes, de progrès a été privée la société civile algérienne contrainte de subir la politique d’uniformisation des consciences de l’État autoritaire en place depuis 1962 ?
Il est temps de mettre fin à cette politique et de permettre à chaque Algérien de vivre sa foi qu’il soit musulman, sunnite ou chiite, mozabite ou ahmadi, catholique ou protestant, juif ou simplement déiste ou athée. C’est de la diversité et de la variété des croyances et des philosophies que les sociétés les plus développées tirent leur force, force amplifiée et consolidée par les libertés individuelles.
L’assujettissement de la majorité
On peut penser que l’absence de liberté religieuse et la présence d’un État rejetant les principes de laïcité correspondent à l’intérêt de la majorité musulmane sunnite et malékite. Il y a certes un intérêt matériel immédiat pour l’exercice de ce culte. Le budget de l’État est mis à profit en période de revenus pétroliers conséquents. Cette dépendance matérielle et financière a un prix qui sera examiné plus loin. Mais la période de vaches maigres qui s’annonce va montrer les limites d’une telle dépendance. La question de la prise en charge des dépenses induites du culte par les pratiquants se posera à plus ou moins long terme au minimum sous la forme d’impôts supplémentaires.
Si la majorité se satisfait de l’absence de liberté religieuse et de neutralité de l’État, elle devra se résoudre à subir la tutelle d’un groupe de fonctionnaires siégeant au Ministère des affaires religieuses et obéissant au doigt et à l’œil du pouvoir politique.
Elle devra continuer à accepter qu’un groupe restreint de fonctionnaires pensent pour elle. Elle devra se considérer comme un bloc compact où ne se manifeste aucune originalité, un groupe uniforme niant toute diversité et où toute manifestation de la personnalité est étouffée. Le bilan d’une telle conception est sous nos yeux. Une production intellectuelle médiocre qui a laissé toute la place à une religiosité à faible spiritualité.
Une pratique religieuse formelle que déplorent nombre de croyants sincères et qui ne promeut pas les valeurs humanistes de l’Islam. La sécheresse cultuelle est le lot de cet embrigadement de la religion par l’État autoritaire. La comparaison avec le Parti du FLN vaut le détour. Alors qu’il était parti unique, le FLN exerçait une dictature impitoyable vis-à-vis des populations locales et des organisations syndicales et de jeunesse. Dans le même temps, la vie au sein des structures du FLN était des plus anti-démocratiques qui soient. Ainsi ces dictateurs à l’extérieur du FLN devenaient à l’intérieur de simples assujettis aux appareils du pouvoir. L’État autoritaire et gestionnaire du culte ne produit pas de richesses intellectuelles, il a pour souci de cultiver la docilité et la servitude.
Libérer la majorité.
La majorité se trouvera d’abord fragilisée si l’adhésion de ses membres ne se fait pas sur une base volontaire, libre et responsable. Cela suppose que chacun de ses membres, à l’instar de tout citoyen, dispose de la liberté de conscience, de la liberté religieuse. C’est une condition indispensable. C’est par la libre réflexion et la conviction de ses membres que la majorité recevra et favorisera une contribution plus élevée de ses membres tant sur le plan matériel, financier, intellectuel et pratique.
Dès lors que les membres de la majorité ne sont pas considérés comme des clones d’un prototype de croyant élaboré par le groupe de bureaucrates logés au Ministère des affaires religieuses, les initiatives seront importantes. La libre collaboration des croyants et pratiquants doit pouvoir se formaliser par la création d’associations et de sociétés privées capables de prendre en charge les coûts des infrastructures et des frais d’exploitation des infrastructures dédiées à la pratique cultuelle.
Cette autonomisation vis-à-vis de l’Administration centrale fera progressivement passer la pratique religieuse du domaine publique au domaine privé. Cette autonomisation sera la garantie de la liberté de conscience et de culte. L’auto-organisation des pratiquants, les fidèles, se distinguera de l’organisation en partis politiques. Cette distinction s’imposera dans la mesure où la formation des partis politiques sera libérée. Mais la condition rédhibitoire, disqualifiant tout mouvement associatif ou partisan sera la même : l’obligation de respecter le socle des libertés individuelles inaliénables et inviolables prescrites par la Constitution et protégées par des institutions qui leur sont dédiées. Cf. « Les Intégristes, le Démocratie et les Libertés »
La liberté religieuse pour tous
D’autre part, la majorité aurait tort de se considérer comme un ensemble uniforme. En fait, elle est une majorité relative, c’est-à-dire une majorité rapportée à un discriminant. Dans notre cas, le culte musulman sunnite et malékite. Mais cette majorité comporte d’autres discriminants secondaires qui sont à la base de la formation en son sein de majorités et de minorités. Salafistes, Soufistes et autres sensibilités et courants religieux rassemblent des partisans. Il n’y a aucune raison du point de vue de la liberté de conscience, de la liberté religieuse de les interdire.
Ces courants religieux sont rivaux. A la condition que les débats soient menés dans un cadre pacifique et conforme au maintien de la paix civile, la majorité verra diverses expériences se dégager de ses « minorités » situées en son sein. Cela ne peut que créer un climat d’émulation et aboutir à des productions intellectuelles et à des pratiques cultuelles novatrices et bénéfiques à la société. L’expression des minorités au sein de la majorité nécessite le respect de la liberté religieuse. Faute de liberté de conscience, cette majorité est vouée à la routine et à la médiocrité et au risque de se couper de la société civile en évolution. Ce qui peut sérieusement remettre en cause son statut de majorité.
Au total, la perspective de l’État de droit rapproche l’Algérie de l’examen de la question religieuse. Les Algériennes et les Algériens aspirent à la jouissance de la plénitude de leurs droits humains. Ils pourront y parvenir si le respect de la dignité humaine et la volonté de vivre ensemble l’emportent sur les sectarismes et les exclusions.