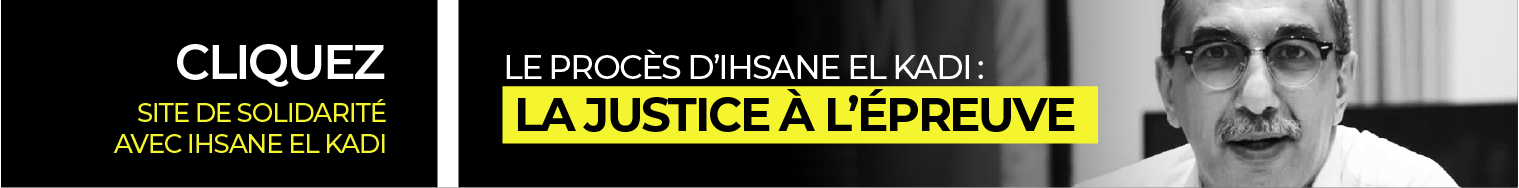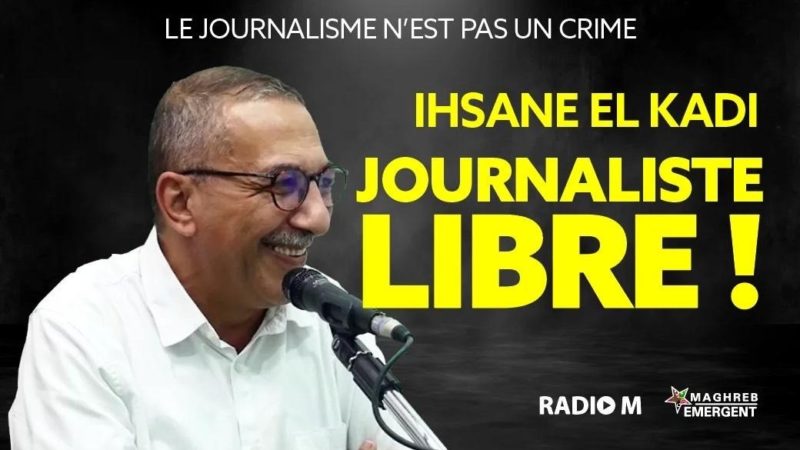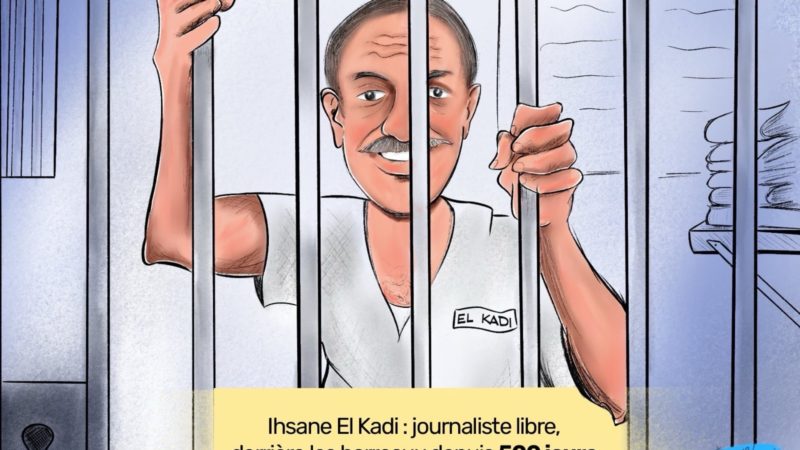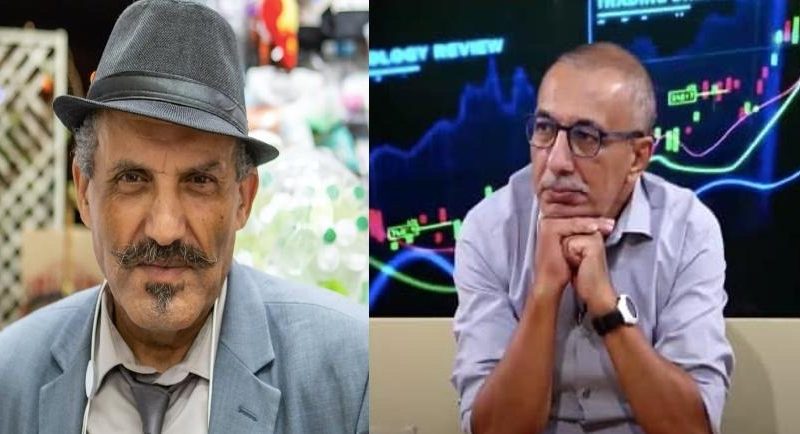Depuis la suspension des manifestations du Mouvement populaire du 22 Février 2019, les services de sécurité et l’appareil judiciaire se livrent à une chasse en règle des animateurs et activistes du Hirak. Arrestations et mises en détention se multiplient alors que la crise sanitaire focalise l’attention de tous les citoyens. La morale d’Etat n’en sort pas grandie. Dans le même temps, la liberté de la presse est menacée avec des arguments d’un autre temps. Le financement étranger est la dernière trouvaille pour intimider les journalistes et les sociétés de presse. Alors que le projet d’une nouvelle constitution est mis en veilleuse, des lois sont adoptées à vive allure qui renforcent l’arsenal législatif de répression. Une stratégie apparaît avec évidence : empêcher le Mouvement de la Société civile de reprendre ses manifestations en faveur d’un changement démocratique et l’émergence de l’Etat de droit.
Une stratégie d’un Etat autoritaire affaibli
C’est une stratégie du court terme qui est mise en œuvre. Elle peut éventuellement porter ses fruits dans le court terme dans les conditions imposées par la crise sanitaire. Cela n’est même pas sûr tant le Mouvement de la Société civile a témoigné d’une créativité imprévisible. Mais ce succès éventuel ne peut être durable. La montée des idées de démocratie et de libertés individuelles est un processus profond. La qualité de la participation individuelle aux manifestations du Hirak en témoigne. Les Algériennes et les Algériens accumulant une expérience politique de près de 60 ans dans le cadre de régimes autoritaires ne peuvent abandonner la voie qu’ils ont empruntée le 22 Février 2019, voie dont ils sont convaincus qu’elle les mènera aux libertés tant espérées. Ils en ont fait une question de dignité comme leurs aînés l’avaient fait pour l’Indépendance de l’Algérie. Évaluer correctement cet état d’esprit des citoyens devrait faire comprendre que la stratégie adoptée par les autorités ne peut conduire qu’à la confrontation. D’autant que le pouvoir qui ne dispose plus du cordon politique et syndical (FLN, RND et UGTA) qui assurait une neutralisation relative de la Société civile, se trouve confiné dans une stratégie du tout sécuritaire. La démonstration de force que le système de sécurité est obligé de fournir traduit l’absence de médiation politique habituellement fournie par l’ancien appareil politique et syndical officiel. La présence ostensible du Commandement de l’Armée dans la vie politique et médiatique n’est pas non plus un signe de force. Le pouvoir manque terriblement d’un bras politique susceptible d’être l’interlocuteur de la Société civile. Or, la situation économique et sociale à venir est lourde de difficultés. Les ressources de l’Etat se rétrécissent considérablement, la politique sociale onéreuse sera difficile à maintenir. Au front politique ouvert par le mouvement de la Société civile du 22 Février 2019 va se greffer un front social d’une ampleur non encore évaluée. Il est réaliste de prévoir un front social dur si cette stratégie du tout sécuritaire se confirmait. Il est connu que les possibilités de dialogue et de coopération s’amenuisent avec l’affirmation d’une politique répressive. Dans ces conditions, face à un Etat qui n’a plus que les muscles à exhiber, un grand acquis politique de la période qui s’écoule, le pacifisme, risque de céder la place à des affrontements préjudiciables au pays.
Un projet d’Etat dominateur d’une Société civile mineure
Ce qui transparaît de la stratégie de confrontation en cours d’application, c’est une conception fondée sur l’inversement des rôles de la Société civile et de l’Etat. A la différence de l’Etat de droit qui est un moyen au service de la Société civile, l’Etat autoritaire se présente comme une fin à laquelle est dévouée la Société civile. Cette inversion autorise tous les autoritarismes. Dans un Etat de droit, les libertés fondamentales constituent les principes généraux qui guident l’architecture constitutionnelle et législative. Ainsi, les notions d’ordre, de sécurité et de morale publics sont conçues pour garantir les libertés fondamentales des citoyens. Il s’agit de préserver et de protéger la sécurité physique des citoyens, leur propriété et le libre exercice de leurs droits fondamentaux. Ces droits sont notamment les libertés d’opinion, d’expression, de circulation, de manifestation et la liberté de la presse. Dans cette optique, le rôle des appareils sécuritaires et judiciaires de l’Etat est d’agir contre les actions qui tendraient à restreindre les libertés des citoyens. Seront donc considérés comme des atteintes à l’ordre public, c’est-à-dire à la tranquillité, à la sécurité et à la salubrité publiques, les actions ou manifestations entravant la liberté des citoyens. Ce peut être le fait de groupes extrémistes recourant à la menace ou à l’agression physiques contre d’autres citoyens. La loi qui amende le code pénal prend le sens opposé. Elle fait l’économie de définir l’ordre et la sécurité publics pour les ériger en objectifs absolus auxquels sont soumises les libertés fondamentales des citoyens. C’est tout le contraire du processus de défense des libertés fondamentales. C’est la porte largement ouverte à l’arbitraire et au déni de justice. C’est une violation du principe de respect de la hiérarchie des normes qui veut que la Constitution qui énonce et garantit les libertés fondamentales est la norme de droit supérieure à la loi. La démarche actuelle du législateur est d’ailleurs frappée du sceau de la partialité dès lors qu’il légifère dans la précipitation alors qu’un projet de Constitution supposé prêt n’est pas encore soumis à l’appréciation des citoyens. La loi amendant le code pénal qui contredit les droits fondamentaux des citoyens confirme cette démarche contraire à la hiérarchie des normes. L’Etat se doit de se comporter comme une personne juridique. Cela le soumet au principe de légalité. Or c’est un Etat au dessus des lois qui se présente devant la Société civile.
Les « fake news », un monopole d’Etat?
Les Etats autoritaires ont la vie dure depuis que internet et réseaux sociaux donnent la possibilité à tout un chacun de s’exprimer, d’échanger les points de vue. Déjà contraints de reculer sur le plan de la presse écrite et audiovisuelle en concédant quelques libertés contrôlées, ils voient le monopole de l’information qu’ils s’arrogent brisé par l’avènement des réseaux sociaux. Dresser des barrières à l’expression libre des citoyens est le trait commun de ces pouvoirs autoritaires. Les Etats russe, chinois, coréen et iranien sont des exemples. C’est apparemment vers ces modèles que tend la volonté du législateur algérien de « moraliser » l’usage des réseaux sociaux. S’appuyant sur les « excès » qui accompagnent la liberté d’expression électronique incontrôlable, il se propose de réprimer les auteurs de « fake news », de fausses informations. L’intention est évidente. C’est la liberté d’expression qui est visée. Pour cela, il grossit démesurément les aspects secondaires de ces fausses informations et de leur impact sur la vie sociale pour voiler l’attaque en règle contre la liberté d’expression. C’est comme si on voulait réduire l’utilisation d’un antibiotique déterminant pour la lutte contre l’infection par l’argument réel des effets secondaires de ce remède qui a considérablement contribué à élever l’espérance de vie des êtres humains. Les régimes démocratiques et tous les citoyens épris de liberté dressent un bilan positif de l’usage des réseaux sociaux. L’apport de ces moyens électroniques dans l’acquisition et l’utilisation des connaissances est inestimable. C’est pourquoi, à la question de choisir entre la limitation du droit d’accès aux réseaux sociaux et le respect de la liberté d’opinion, ils répondent par la deuxième option. Seuls les régimes autoritaires toujours soucieux de limiter la parole de la société civile optent pour la répression. La notion de « fausse information » est l’objet de diverses interprétations. Les Etats et leurs gouvernements sont considérés comme les premiers producteurs d’informations fausses, obnubilés qu’ils sont par leur volonté de faire taire les critique de leurs bilans et actions. Il est reconnu que les fausses informations provenant des gouvernements impactent plus sérieusement la vie économique et sociale. En l’absence de contre-pouvoirs et avec une presse subventionnée et infléchie, l’Etat autoritaire s’arroge le monopole des « fake news ». Il se dérobe ainsi une nouvelle fois à sa responsabilité de personne juridique soumis à la loi. L’Etat au dessus de la loi et de la société civile reste le credo des pouvoirs autoritaires.
La sûreté de l’Etat et la sûreté individuelle
Le même raisonnement marque l’invocation de la « sûreté de l’Etat » pour attenter aux libertés individuelles. La sûreté de l’Etat se définit comme la protection de l’Etat contre une menace d’agression ou une agression. L’atteinte à la sûreté de l’Etat relève de la menace intérieure. L’espionnage et la trahison en sont les manifestations particulières. Les conflits politiques ne relèvent pas d’une menace intérieure. Contenus dans un cadre pacifique, ils sont l’expression des rivalités qui traversent inévitablement une société. La démocratie est le cadre de résolution de ces rivalités. Assimiler les conflits politiques internes à une menace intérieure contre l’Etat c’est considérer l’Etat comme le bastion ou la propriété d’une force ou coalition politiques. Dans cette logique, toute volonté de changement de pouvoir s’assimile à une action subversive. Cette conception patrimoniale de l’Etat remet fondamentalement en cause la nature de l’Etat en tant qu’instrument de l’ensemble de la Société civile. De ce fait, en l’absence de mécanismes démocratiques pour opérer les changements souhaités par la Société civile et donc en l’absence de possibilité d’alternance, s’instaure un monopole du pouvoir. La sûreté de l’Etat est ainsi transformée en défense du monopole politique. Il s’ensuit qu’elle est dirigée contre les droits fondamentaux des citoyens. Si l’Etat se conçoit comme un moyen au service de la Société civile et donc neutre politiquement, on doit considérer la sûreté de l’Etat comme un moyen de garantir la sûreté personnelle des citoyens. Son invocation abstraite et confuse comme protection absolue de l’Etat partial conduit à l’instrumentaliser contre les libertés individuelles.
L’atteinte à l’unité nationale, un tour de prestidigitation
Enfin, une supposée atteinte à l’unité nationale est brandie pour à nouveau légitimer une politique de répression qui viole la liberté d’opinion et la liberté de la presse. Encore une fois, le législateur se dispense de définir l’unité nationale pour abuser du recours à une notion maintenue volontairement dans le flou. L’unité nationale est une conquête historique du peuple algérien. Les Algériennes et les Algériens se sont exprimés d’une manière éclatante lors du référendum d’autodétermination le 01 juillet 1962 qui venait mettre fin à la guerre de libération nationale. Ils ont marqué leur accord pour que l’Algérie soit délimitée territorialement dans des frontières définies et reconnues internationalement. Ils se sont également définis comme la population occupant ce territoire et constituant la composante humaine de la Nation algérienne. Ils se sont prononcés pour un Etat algérien souverain indépendant de l’ancienne puissance coloniale. Par ces trois éléments fondateurs, ils ont réalisé la tâche historique de l’unité de la Nation, de l’unité nationale. L’unité nationale est une question réglée en 1962. C’est dans ce cadre national que les Algériens entendent exercer leurs droits humains fondamentaux. Ils revendiquent par conséquent un Etat démocratique, un Etat ouvert au pluralisme politique. L’atteinte à l’unité nationale consisterait à remettre en cause le territoire, la population et la souveraineté acquise après le référendum de Juillet 1962. Cela n’a jamais été le cas. En réalité, ce qui est en cause c’est l’identification de l’État à une partie politique. Cette identification de l’État à une partie politique aboutit à assimiler les luttes politiques internes inévitables au sein de la Nation à des tentatives de divisions territoriale ou démographique de la Nation. C’est un tour de prestidigitation que les partisans du monopole du pouvoir ont réussi à infliger aux Algériennes et aux Algériens depuis 1962. Pourtant, si nous considérons le référendum populaire de 1962, il ne contenait pas l’accord du peuple algérien pour un pouvoir monopolisé par une partie politique. Bien au contraire, consignés dans la Déclaration du 1er Novembre 1954 et dans la Plate-forme de la Soummam, les idéaux de liberté continuaient d’éclairer les aspirations des Algériens à la démocratie. L’unité nationale doit être préservée des instrumentalisations idéologiques qui servent sous le paravent de l’unité, qu’à l’égarement de la justice.
La confrontation avec la Société civile n’a pas d’avenir
Au total, la conception de l’Etat fort érige l’Etat en puissance absolue et conduit à la soumission de la Société civile. Ce qui entraîne le sacrifice des libertés individuelles. C’est la voie déjà expérimentée depuis l’Indépendance, de la perte de l’adhésion des citoyens, de leur l’initiative et de leur créativité. C’est le règne de la bureaucratie étouffante et du recours aux méthodes autoritaires. Un Etat peut être fort par sa capacité à protéger la Société civile, ses libertés et la démocratie. La stratégie de l’Etat fort à bon escient n’est pas incompatible avec une Société civile dynamique. Elle doit prendre en considération la tendance lourde qui imprègne la Société civile, tendance à l’émancipation et à la responsabilité citoyennes. L’Etat doit évoluer et subir les transformations démocratiques qu’impose une Algérie équilibrée par une Société civile libérée et un Etat au service de la Société civile. L’avenir de l’Algérie n’est pas dans la confrontation Etat-Société civile. L’avenir de l’Algérie est dans l’instauration d’un Etat de droit qui réconcilie la Société civile et l’Etat. Il est dans la paix civile. Il est dans l’épanouissement de ses citoyens. Il est dans les libertés individuelles inaliénables et la démocratie.