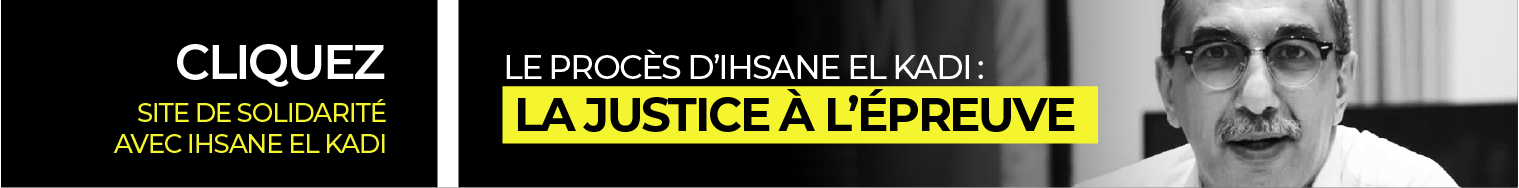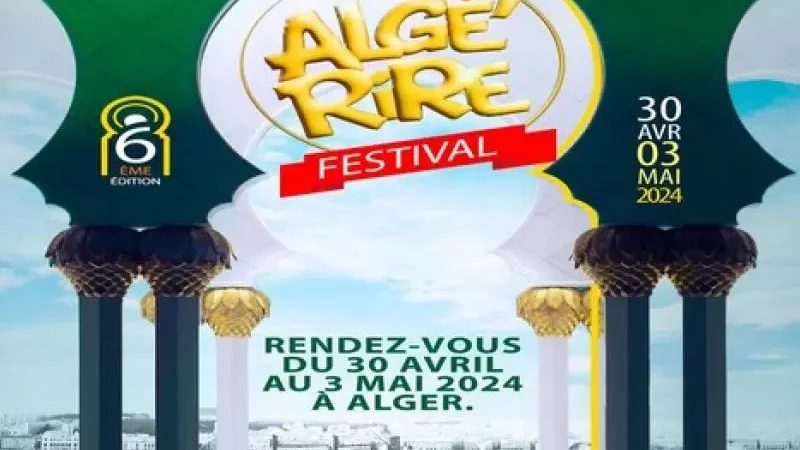Le cinéaste russe Pavel Lungin n’a pas caché ses sentiments anti militariste, lors d’une brève rencontre dans la deuxième salle de l’Opéra du Caire, où se déroule le 41 ème Festival international du cinéma du Caire. Il présentait son nouveau long métrage “Leaving Afghanistan” (Quitter l’Afghanistan) sur le retrait des troupes soviétique de ce pays asiatique entre 1988 et 1989 après les accords de Genève . “Ecoutez la vérité dite par les soldats, pas par les généraux. La guerre est un moment où s’entremêlent les sentiments. Certains pensent être coupables, d’autres victimes”, estime ce cinéaste au long parcours. Il a été révélé, en 1990, avec son film “Taxi Blues”. Il a réalisé aussi des films appréciés par le public en Russie et ailleurs comme « Luna Park », sur le racisme, “La noce” et “La dame de pique”, inspiré de l’oeuvre de Tchaïkovski. En Russie, “Leaving Afghanistan” a failli être censuré. “Certains officiers de l’armée, des généraux à la retraite notamment, n’ont pas aimé le film, ont voulu l’interdire pour ne pas donner un mauvais exemple aux jeunes russes. Mais, des vétérans de la guerre m’ont soutenu disant qu’il fallait projeter le film tel qu’il est», confie le réalisateur. Son long métrage, qui ne sortira pas dans les salles dans certains pays européens pour des raisons inconnues, est construit à partir de faits réels. Après le crash de son appareil, le pilote Alexandre Vassiliev est capturé par les combattants afghans dans les montagnes. Il est le fils du général opérationnel Vassiliev. Le haut gradé charge la 108 ème division d’infanterie de sauver le captif avant se retirer du pays. La mission s’avère compliquée parce que les soldats sont fatigués, veulent rentrer chez eux, n’en peuvent plus des combats. Certains ont peur, d’autres font des affaires, d’autres encore volent les biens des afghans, mangent dans leurs marmites. Les images du films sont parfois cruelles, le réalisateur a laissé les gouttes de sang jaillir sur la caméra comme pour suggérer que la guerre n’est pas un jeu vidéo ni une partie de plaisir. Le long métrage, qui n’a pas cherché à comprendre les raisons politiques de la présence des troupes soviétiques en Afghanistan, est une critique sévère du fonctionnement militaire en période de fin de guerre durant laquelle les décisions personnelles d’un haut gradé peuvent être fatales. Le cinéaste a averti les spectateurs dès le début du film : “La fin de la guerre est pire que son début”.
″ Haifa Street”, ni bourreau ni victime
“Haifa Street” est un autre film sur la guerre, vue autrement, dans un autre endroit du monde. Avant la projection de ce film, dans la section « Horizons du cinéma arabe”, le réalisateur irakien Mohanad Hayal, 34 ans, a demandé aux présents d’observer une minute de silence pour “les victimes de la répression actuelle” en Irak en évoquant les manifestations de Baghdad, Basorah et Nassiriyah. “En Irak, les jeunes révoltés affrontent les poitrines nues les balles de snipers, attachés à leur identité irakienne ancienne. Une identité qui leur a été volée. Aujourd’hui, ils sont entrain de la reprendre pour qu’en Irak on vit ensemble dans la paix”, a déclaré Mohanad Hayal comme porteur d’un message. A Baghdad, en 2006, Haifa Street était un quartier dangereux. Les différentes factions s’y livraient à des batailles continuelles sur fond de haine communautaire et de sectarisme. Mohanad Hayal a voulu raconter ce moment tragique de l’Histoire contemporaine de l’Irak en suivant Salam, Sniper installé le haut d’un immeuble, qui tire sur Ahmed, un photographe vivant aux Etats Unis, venu demander la main de Souad, une femme de 45 ans vivant avec sa fille et espérant vivre ailleurs. Il ne laisse personne s’approcher de lui. Vengeance personnelle? Règlement de comptes? Déshumanisation? En temps de guerre et de haine généralisée tout est possible et le pire n’est jamais loin. Le film, qui se déroule dans un huis clos ouvert, explore l’idée de la vie avec la mort. Une idée très répandue dans le cinéma irakien de ces quinze dernières années. Cela a couvert ce cinéma d’un gris persistant où il est pénible d’y trouver des lueurs d’espoir ou des lueurs tout court. La guerre a presque tout détruit en Irak. “En Irak, nous vivons le moment comme si c’était le dernier de notre existence. Nous pouvons vivre un moment de bonheur ou de tristesse et la vie s’arrête brusquement après”, a déclaré Mohanad Hayal qui a confié ne pas vouloir “travestir” la vérité, mais la livrer telle qu’elle est. Dans son film, qui reste une fiction basée sur des faits réels, il a évité de trancher entre le bourreau et la victime, laissant le champs ouvert à toutes les lectures même si le récit paraît parfois non convaincant, pénible. La critique du phénomène religieux y est visible et audible à travers la présence persistante des récitations coraniques dans des moments durs. “Haifa Street”, qui a été sélectionné au dernier festival de Venise, a obtenu le grand prix au festival de Busan en Corée du Sud, un festival émergent en Asie