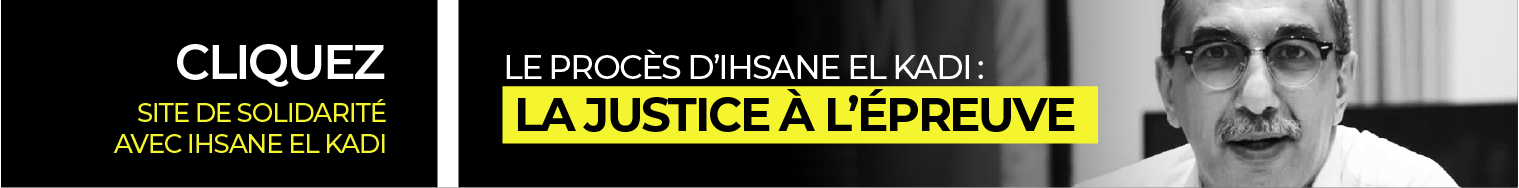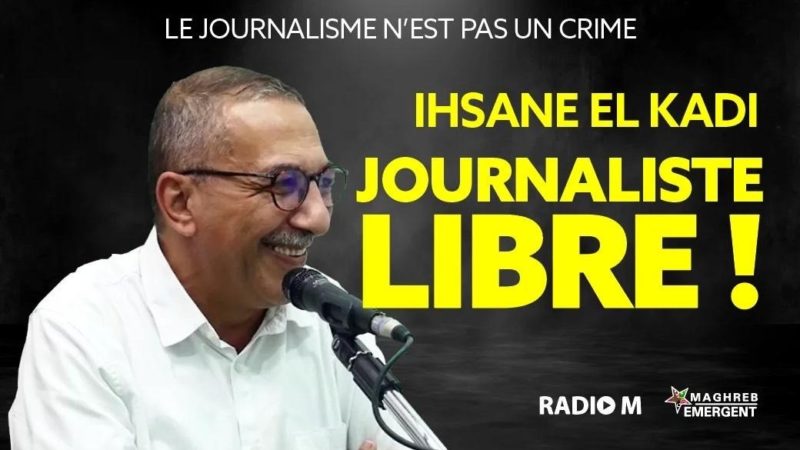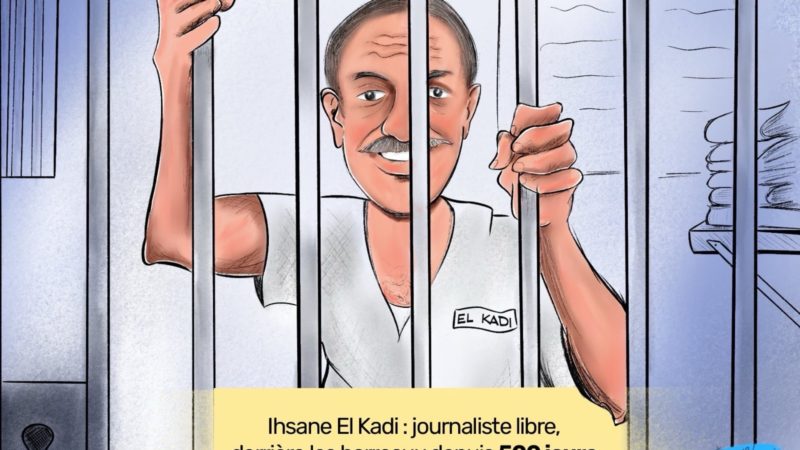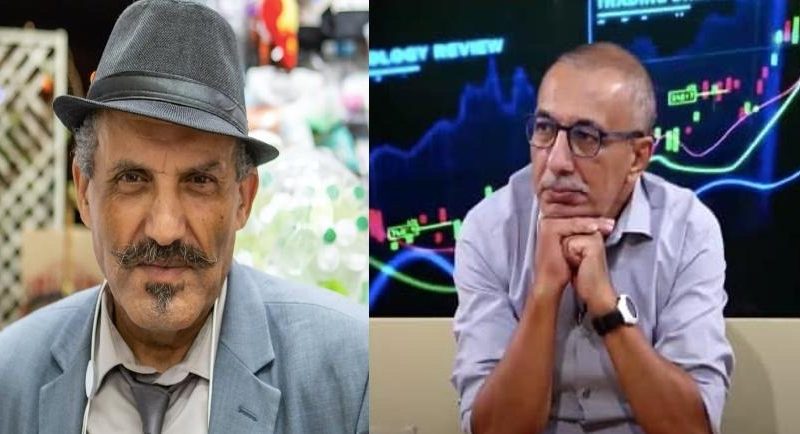C’est une mémoire qui se constitue et témoigne d’un présent historique pour le moins exceptionnel, celui d’une révolution qui entame sa deuxième année . Par son ampleur , son pacifisme, et sa profondeur, le Hirak algérien ce mouvement du 22 février 2019, est la catharsis de plusieurs périodes de l’histoire contemporaine du pays qui se télescopent : l’Indépendance en 62, octobre 88, le printemps berbère, la décennie noire.
Les symboles sont là, les drapeaux se déplient au vent, certains s’affichent sur les murs . Les couleurs se saturent autour du vert, du blanc et du rouge sous un ciel bleu et un horizon méditerranéen. Chaque mardi, chaque vendredi, les rues se remplissent de slogans, de chants, de tifos, d’affiches, de galettes ou baghir à partager. La joie et la détermination de lutter pour un avenir où la justice, la liberté et l’égalité seraient un indépassable, une règle de vie commune.
Dans ce contexte, femmes et hommes ont manifesté chaque mardi, chaque vendredi et on a vu émerger dans les marches « un carré féministe », non pas que les revendications féministes soit un combat récent dans le pays, chacune et chacun se rappellent des luttes pour l’abrogation du Code de la famille . Mais voilà, les femmes ont fait la guerre d’Algérie mais n’ont pas porté le récit .
Le 22 février a vu l’éclosion des images en nombre . Des villes d’Alger à Oran, Constantine, Bejaia, Tizi Ouzou ou Jijel, les espaces se précisent entre la mer et le ciel.
Le récit se déploie d’est en ouest autour de la baie d’Alger ou du boulevard Front de mer d’Oran ou de la place d’Armes, du Sud au Nord à l’Est .
Les photographes s’en sont emparés , des photographes femmes dont Lydia Saïdi avec la recherche de la lumière et des transparences, Kadidja Markemal et la force des corps, Jamila Loukil témoigne sur l’état dégradé du pays et de sa ville Oran en particulier .
Sur ce plan la photographie féminine sort du cadre traditionnel des photos de la vie quotidienne ou de l’intime pour s’inviter dans la rue, dans les manifestations, adhérant par là à une revendication politique et donc à une appropriation de l’espace public par les femmes aux côtés de leurs camarades .
Loin des réseaux et des cooptations des hommes entre eux, elles se sont saisies du médium et interrogent la société, inventent leur vocabulaire visuel. Elles descendent dans la rue, photographient le chômeur, l’enfant, les rides d’un visage, le sourire d’un jeune homme, une femme abandonnée avec son enfant, la solidarité d’une main posée sur une épaule. Leurs regards frappent, la puissance esthétique est là, la dignité et l’empathie aussi.
Toutes nous parlent de l’épopée du Hirak , et nous sommes loin des activités domestiques, de la photographie instrument de mémoire et de transmission familiale, lieu du souvenir. Toutes, chacune à sa manière et dans son style nous fait le récit de cette refondation des rôles sociaux en marche dans cette année si particulière dans l’histoire de l’Algérie . Ces images revendiquent le droit à la réinvention de la mémoire, elles témoignent des mutations en cours, de reconfiguration des rapports femmes/hommes et de l’individu à la société, au groupe, à la famille. Elles donnent parfois à voir ce qui est invisible :la complicité, la solidarité, la tendresse, la fraternité, l’espoir de ces femmes et hommes entrés en révolte qui ont toutes et tous une expérience intime de la domination et de l’humiliation.
Dans ces photographies, l’Algérie contemporaine y est présente avec sa beauté mais aussi ses blessures infligées par un système politique et économique figé, qui a vécu de la rente pétrolière sans se préoccuper de l’avenir de sa jeunesse, et une mondialisation subie avec un capitalisme sauvage. Ce sont autant d’archives, autant de repères pour nos mémoires et cette iconographie est précieuse pour la construction du roman national, en effet la participation des femmes photographes est nécessaire pour que ce récit soit complet et utile aux générations qui arrivent. L’enjeu est de taille pour une construction identitaire équilibrée, juste et épanouie.