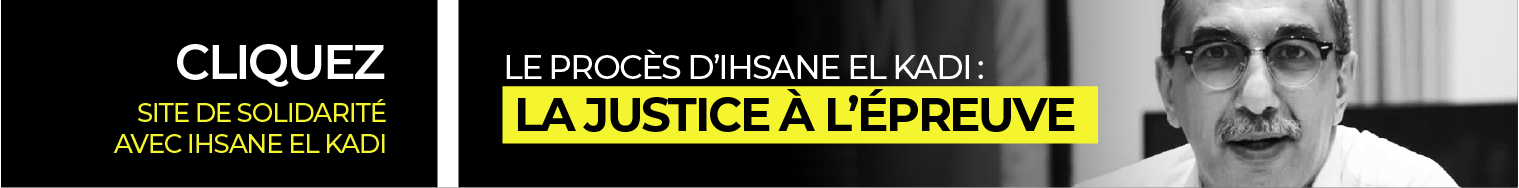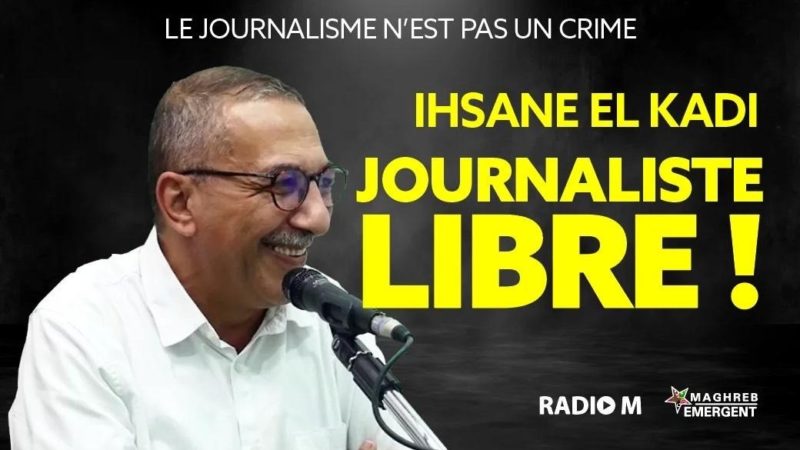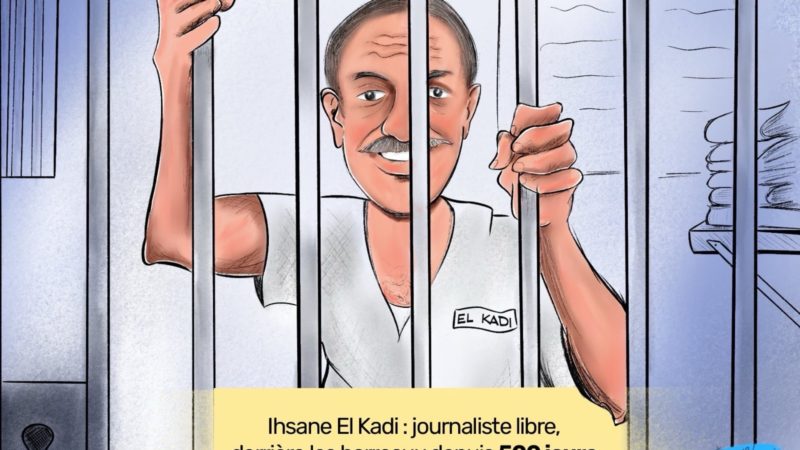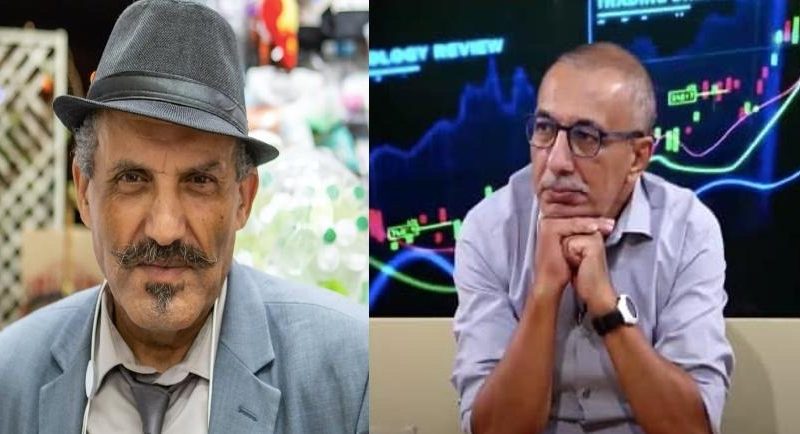Parmi les chroniqueurs ou experts qui éclairent fort bien l’opinion publique sur la valse des prix du pétrole, une voix préconise un « engagement dans le patriotisme économique » parce que « la véritable force de notre pays réside non pas dans les ressources de notre sous-sol mais dans leur (les Algériens) patriotisme ». L’Algérie a-t-elle souffert depuis l’Indépendance d’un manque de patriotisme de ses citoyens et gouvernants ? C’est une question fort embarrassante. Même s’il est connu que le patriotisme peut constituer un stimulant momentané, aucune école économique sérieuse ne fonde les lois de l’économie sur le volontarisme fut-il patriotique. L’exemple de Sonatrach comme « la démonstration de cette vérité » est loin d’être convainquant. Une étude sérieuse de ses bilans économiques dans des conditions de transparence révélerait le gaspillage important des ressources et la sous utilisation de « l’intelligence » nationale. Alors que comprendre par « patriotisme économique »?
«Le patriotisme économique », la suprématie de l’État
Patriotisme ou nationalisme ? La préférence donnée à la Patrie par rapport à la Nation est secondaire sur le plan économique tant ces deux notions recouvrent la même réalité. Mais elle traduit plutôt le souci des porteurs du « patriotisme économique » d’échapper à l’accusation de chauvinisme accolée souvent au nationalisme. Peut-être faut-il y voir aussi la volonté d’afficher une orientation qui ne tranche pas violemment avec l’internationalisme traditionnel de la gauche par opposition au nationalisme étroit, apanage des partis d’extrême droite en Europe. Mais cette distinction perd de sa consistance d’abord sur le plan politique dans la mesure où extrême droite et extrême gauche se disputent « la préférence nationale ». Mais aussi, dès lors que le débat se replace sur le terrain économique. Le principe essentiel du « patriotisme économique » c’est qu’ « Il faut instaurer le principe de la préférence nationale de manière absolue ». En termes plus clairs, favoriser prioritairement les producteurs nationaux et éloigner les fournisseurs étrangers du commerce intérieur. Les moyens pour aboutir à cette « préférence nationale » sont connus. Ce sont les droits de douanes pour gonfler les prix des produits importés, la réglementation avec des interdictions d’importer, des injonctions administratives aux producteurs et les entraves procédurières. Toutes ces recettes relèvent du protectionnisme et ont été mises à l’épreuve depuis l’Indépendance par l’économie dirigée que ce soit sous la forme du socialisme ou de l’étatisme aménagé, c’est-à-dire laissant un peu de place au secteur privé. Les résultats sont également connus. Le bilan économique de l’Algérie, c’est le bilan du protectionnisme encore en vigueur. La surestimation du poids de la corruption et des dilapidations dans l’évaluation de ce bilan peut laisser penser qu’un comportement plus moral des acteurs économiques et politiques permettrait de donner des résultats plus profitables au pays. Qu’en est-il vraiment ?
Le « patriotisme économique », l’économie administrée
L’économie connaît deux modes de régulation : la régulation par le marché et la régulation par l’État. Ces deux modes n’existent pas à l’état pur dans les différentes économies nationales. Un des deux modes est largement dominant dans chacune de ces économies. Les ex-pays socialistes et, actuellement la Corée du Nord, sont les exemples d’économie où la régulation par l’État a été poussée à l’extrême. Les pays occidentaux, principalement anglo-saxons, présentent une prépondérance de la régulation par le marché. La régulation par le marché repose sur l’équilibre en évolution de l’offre et de la demande de marchandises et de services. Ce sont les choix des consommateurs dotés d’un pouvoir d’achat qui expriment la demande. Les entrepreneurs orientent leurs investissements, donc l’offre, pour satisfaire la demande. Par quel moyen de communication, l’offre s’adapte-t-elle à la demande ? Par le système des prix. Par la connaissance des prix des marchandises dont dépend le chiffre d’affaires et ceux des matières premières et équipements que l’entrepreneur va envisager son bénéfice et orienter son investissement. Le grand handicap de la régulation supposée par l’État, c’est l’impossibilité de rassembler au niveau des « planificateurs » la totalité des informations relatives aux prix, handicap aggravé par les prix administrés, les prix décidés par les « planificateurs », par l’État. Pour l’anecdote, au temps de l’URSS avec son gigantesque Gosplan (institution de planification), les membres du Politburo (organe dirigeant de l’État et du parti unique) recevaient un relevé des prix des pays occidentaux. Ce qui ne servait pas à grand chose, les réalités économiques étant différentes. Cela n’empêchait pas ce Gosplan de déterminer ce que va consommer le citoyen soviétique et ce que vont produire l’agriculture et l’industrie. La pénurie endémique et les chaînes légendaires illustrent à jamais l’économie socialiste. On pourrait objecter que le « patriotisme économique » n’est pas un étatisme de l’ampleur de celui des pays socialistes. C’est vrai. Mais par la place qui revient à l’État, il présente beaucoup de similitudes. Les décisions politiques prévalent sur les lois économiques. L‘implantation en Algérie de l’industrie automobile totalement inadaptée au marché en est le parfait exemple. La place considérable que prend la réglementation, droits de douanes, autorisations administratives, procédures lourdes et entraves bureaucratiques, entraîne également, phénomènes aggravant, la possibilité du favoritisme, du népotisme, de la corruption et de la dilapidation du bien public.
Á qui profite le « patriotisme économique »?
Comme déjà affirmé plus haut, le principe essentiel du « patriotisme économique », c’est le protectionnisme sous l’étendard de «la préférence nationale». Ainsi affichée, cette intention semble reposer sur une évidence : l’intérêt de cette « production nationale » se confond avec l’intérêt des citoyens algériens. En réalité, la priorité donnée à la production nationale ne concerne qu’une partie des industriels, des dizaines voire une centaine. Ces derniers ne subiront pas les effets stimulant de la concurrence et profiteront ainsi d’une situation privilégiée. Ils imposeront leurs prix forcément plus élevés que les produits importés et les consommateurs subiront ces marchandises sans rivales. Des millions de consommateurs algériens paieront le surplus de prix qu’ils soient acheteurs directes des marchandises ou par la répercussion des coûts imposés aux autres industriels transformateurs de ces marchandises « protégées ». Le surenchérissement de ces marchandises entraîne une ponction du pouvoir d’achat des consommateurs. Cette part de pouvoir d’achat confisquée aurait pu être utilisée à la consommation d’autres produits. Ce sont à leur tour d’autres industriels qui sont lésés par la réduction du pouvoir d’achat des consommateurs, leurs produits trouvant moins d’acheteurs. Un argument souvent invoqué se rapporte à la création ou à la préservation des emplois. Là aussi ce sont les intérêts de centaines de salariés qui sont opposés à ceux de millions de consommateurs. Or justement ces millions de consommateurs sont également créateurs d’emplois par la demande créée par la préservation de leur pouvoir d’achat. Le protectionnisme a ses « élus » et ce ne sont pas les consommateurs qui les élisent. Ce sont les Ministères et autres institutions de l’État qui les désignent. La probabilité pour que tenants du pouvoir et affairistes de connivence trouvent le terrain propice à leurs intérêts respectifs est plus que forte. C’est donc à une catégorie minoritaire d’industriels que le « patriotisme économique » profite. Pas aux millions de consommateurs encore moins aux bas revenus.
Le « patriotisme économique » favorise le parasitisme d’État
Le « patriotisme économique » en servant de support à des pouvoirs étendus des appareils de l’État intéresse également tout un ensemble de hauts fonctionnaires dans l’Administration et les entreprises publiques, « les sociétés nationales ». C’est cette coalition dans l’Administration, dans l’économie et les milieux politiques que le Président déchu avait réussi à constituer pour s’assurer 20 ans de règne. Ce scénario peut se répéter avec de nouvelles équipes car l’économie d’État en offre d’une manière systémique l’opportunité. Les avantages « sociaux » dont bénéficie cette « bourgeoisie bureaucratique » sont des attracteurs puissants. Le scandale des soins à l’étranger réservés aux hauts fonctionnaires et autres privilégiés de l’étatisme renseigne bien sur le « progrès social » célébré par les idéologues du « patriotisme économique ». A l’inverse, l’économie de marché qui se fonde sur l’épargne, l’accumulation des capitaux et les investissements favorisés par la liberté économique et des institutions de crédit exclut dans des conditions de concurrence une telle intervention néfaste des appareils du pouvoir. L’État reposant sur des institutions représentatives veille dans ces conditions au respect des règles de concurrence. En Algérie comme au Venezuela et dans d’autres pays pétroliers, la rente pétrolière a longtemps fourni les moyens financiers et rendu secondaires l’épargne et l’investissement privés. C’est la raison pour laquelle les hydrocarbures représentent 90% des recettes d’exportation et 65% du budget de l’État. L’Algérie se trouve ainsi suspendu au cours du baril de pétrole. La fin de la dépendance des hydrocarbures appelle d’ambitieux investissements qui à leur tour appellent épargne et accumulation de capitaux. Ce sont les investisseurs privés nationaux et étrangers qui peuvent répondre à ce besoin pressant du pays. La richesse des Nations repose sur la division du travail et la coopération internationale. Le « patriotisme économique » conduit à la réduction des possibilités gigantesques offertes par la mondialisation. Il condamne l’Algérie aux illusions du « souverainisme » et de « l’autosuffisance ». Même la Chine communiste s’est résolue à s’ouvrir au monde et à adopter l’économie de marché avec les résultats que nous constatons aujourd’hui. En cette période de lutte contre la propagation du coronavirus, les succès des pays tels que la Corée du Sud, Taiwan, Singapour et Hong Kong dont l’économie est basée sur le marché sont riches d’enseignements. L’avenir de l’Algérie est dans l’économie de marché, la démocratie et les libertés, facteurs essentiels des progrès des pays avancés. Elle n’est certainement pas dans le confinement de son économie.