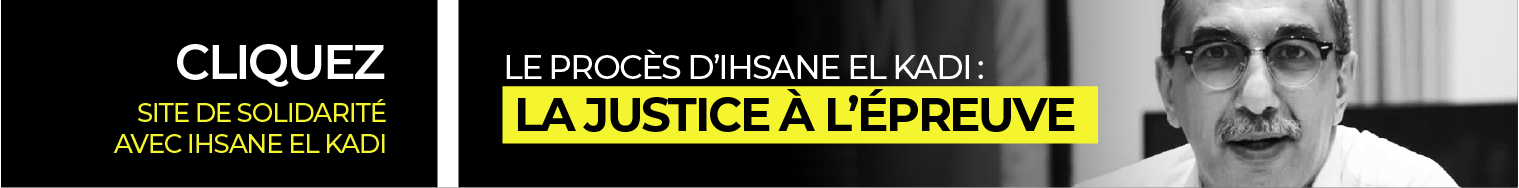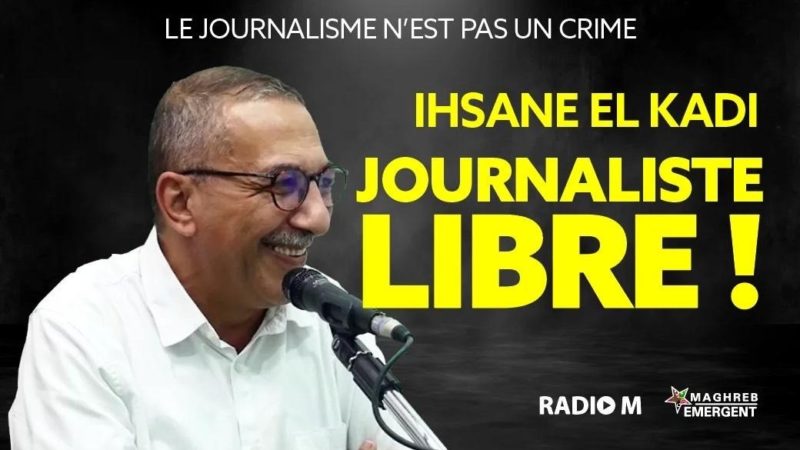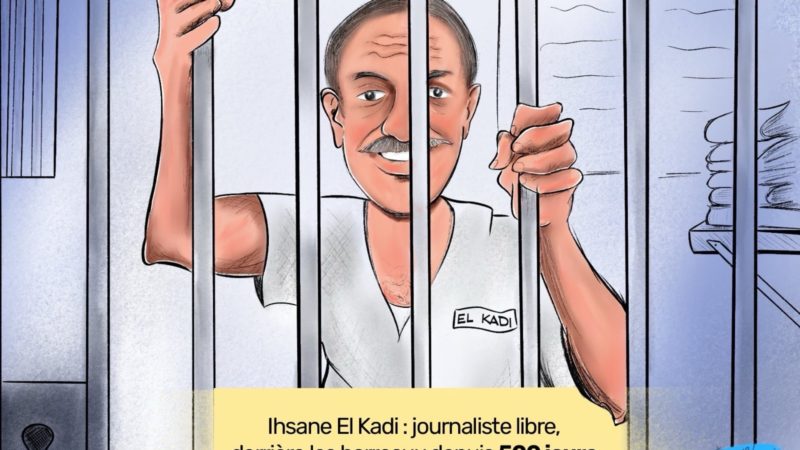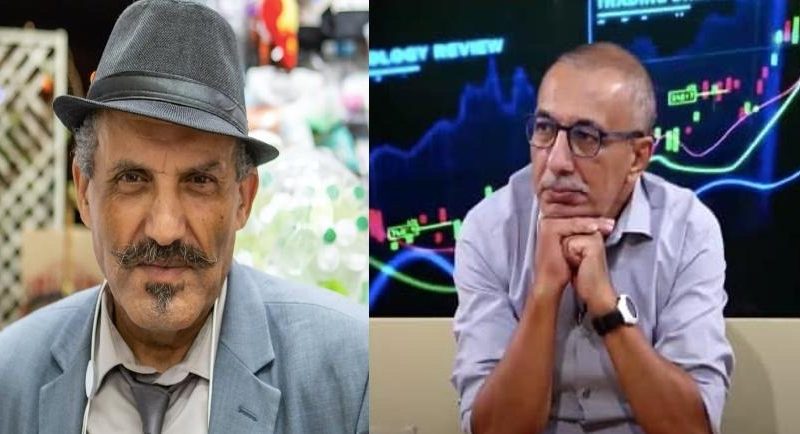La récente rencontre entre des animateurs ou leaders du Hirak avec Ali Belhadj, figure emblématique de l’ex-FIS, a légitimement provoqué un débat. Ce débat est passionné. La « décennie noire » ou « tragédie nationale » a laissé de graves séquelles tant les pertes en vie humaines ont été considérables. Sortir de ce climat passionnel est impératif parce que la question soulevée, la place des Islamistes dans la vie politique nationale, mérite une attention particulière et la réponse apportée aura des incidences importantes sur l’avenir du Hirak et plus largement sur celui de l’Algérie.
Surmonter la sanglante confrontation des années 90.
Aborder les questions politiques soulevées au cours de cette période récente de l’histoire de notre pays est essentielle. Ce n’est pas ignorer les victimes et les peines endurées par leurs familles et amis, que de faire l’effort d’aller à la racine des événements et d’en dégager les traits essentiels.
1- Le régime en place depuis 1962 s’inscrit dans la logique de l’Etat autoritaire. Il a alterné la répression contre les forces socialistes et contre les forces islamistes. Il a chaque fois suscité l’appui des uns contre les autres. Ainsi, intégrées dans le FLN, les Islamistes ont soutenu les mesures sectaires d’arabisation expéditive et d’instrumentalisation de la religion. Ils ont cautionné et réclamé la répression engagée contre les forces de gauche. Lorsque le pouvoir s’est orienté dans la voix socialiste, il a reçu le soutien de la majorité des forces de gauche qui à leur tour se sont réjouis des coups portés aux forces islamistes. Chacun de ces deux pôles idéologiques, situés de part et d’autre du courant central dominant du nationalisme autoritaire, ne revendiquait plus de liberté qu’au profit de leurs courants. La logique de la confrontation dominait et les perspectives données par l’accroissement de l’influence d’un courant ne pouvait que provoquer la crainte d’une répression pour l’autre. La vie politique nationale se trouvait amputée de forces se revendiquant des libertés et des droits de l’homme. L’influence réduite d’hommes politiques comme Ferhat Abbas et Aït Ahmed est révélatrice de la faiblesse de ce courant rassembleur et stabilisateur de la société civile.
2- La montée du courant islamiste dans les années 80 s’est présentée comme un mouvement de contestation du pouvoir établi. Il a pu ainsi drainer un grand mouvement populaire lassé par le règne arbitraire du parti unique et sensible à l’affaiblissement des capacités de redistribution sociale du pouvoir. Le mouvement islamiste s’est en même temps présenté comme porteur d’un projet politique liberticide. Il le proclamait ouvertement sûr de son adéquation à l’idéologie religieuse sectaire qui le fondait. Ce mouvement conquérant menaçait à la fois le pouvoir en place, autoritaire et hégémonique, et les forces politiques qui se réclamaient de la démocratie, qu’elles soient de gauche ou simplement attachées à un minimum de libertés pour les citoyens. Il a la particularité d’avoir partagé avec le FLN l’utilisation de la violence dans les confrontations politiques à l’Université et dans les autres secteurs de la vie politique nationale. La victoire du FIS aux élections législatives en 1991, victoire qui lui aurait permis d’accéder au gouvernement du pays a donc suscité l’opposition du Commandement militaire qui se trouvait contesté et des courants politiques, globalement appelés démocrates, inquiets pour la sécurité et la liberté des citoyens.
3- Mais le mouvement appelé démocrate s’est divisé, scindé en deux tendances, autour de la question de l’interruption du processus électoral. La première tendance a appuyé la décision de l’Armée d’annuler les élections législatives. La deuxième s’est opposée à cette annulation. La première s’est vue traitée « d’éradicatrice » parce qu’elle était accusée de nier l’existence dans la société de courants d’opinion représentés par le FIS. La deuxième était qualifiée de « conciliatrice » parce qu’il lui était reproché une sous-estimation des conséquences de la prise du pouvoir du FIS sur la vie et les libertés des citoyens. La première se prononçait pour l’interdiction ou la limitation des partis islamistes. La deuxième estimait que la démocratie permettait l’existence de partis fondés sur une idéologie religieuse. Dans les faits, la tendance qui a soutenu l’Armée ne s’est pas préoccupée des méthodes contraires aux droits de l’Homme qui ont caractérisé la lutte contre le terrorisme islamiste. La tendance hostile à la décision de l’Armée a noyé la barbarie du terrorisme dans un équilibrisme entre le « tout sécuritaire » de l’Armée et les assassinats et les destructions des islamistes avec cette question semeuse de doutes: « qui tue qui ? ». Il appartient aux travaux historiques à venir d’établir la vérité des faits. La question politique qui ressurgit et qui s’est invitée dans l’actualité, c’est quelle est la place des partis islamistes dans la société civile ?
Quelle place pour les Islamistes dans la Société civile ?
La question d’actualité et résolue dans la pratique par le Hirak ne reçoit pas encore de réponse théorique correcte. Ce qui explique les va-et-vient dans les positions des divers courants idéologiques. Les arguments circonstanciels évoluent au gré des situations. Il est possible avec l’éclairage de l’expérience de l’humanité de distinguer les réponses à cette question.
1- La réponse autoritaire.
Cette réponse est suggérée par l’article 52 de la Constitution qui dispose dans un de ses alinéas : « Dans le respect des dispositions de la présente Constitution, les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, raciale, de sexe, corporatiste ou régionale. ». L’interprétation la plus poussée de cet article a conduit à la proposition d’interdiction des partis islamistes. Cette réponse est autoritaire au sens où elle contrevient à une liberté fondamentale, la liberté d’opinion. Pourquoi des opinions fondées sur des valeurs religieuses qui sont des valeurs humaines bien souvent antérieures aux religions, seraient frappées d’interdiction. Cette interdiction ne peut être vécue par les citoyens privés de leur expression politique à travers un parti que comme une discrimination. Elle est donc facteur de conflits et de contradictions insurmontables au sein de la société civile. Privées du cadre légal, ces idées dont l’implantation dans la société est incontestable, se trouveront portées dans la violence. D’autre part, l’instrumentalisation de la religion par l’Etat est une forme de constitution d’un parti politique religieux dans la mesure où l’Etat concret, c’est l’Etat des gouvernants et ces gouvernants sont une caste qui se voit réserver l’usage de la religion à des fins politiques. En fait, le souci du pouvoir autoritaire est de n’accepter de place à la religion que dans l’Etat mais pas dans l’opposition. L’interdiction des partis fondés sur des bases religieuses n’est pas une solution durable. D’autre part, elle s’appuie sur des apparences qui sont loin de correspondre à l’objectif d’écarter la religion du champ politique. Ainsi, par la magie d’un changement de sigle, des partis connaissent une existence légale bien qu’il est connu qu’ils s’appuient sur une interprétation sectaire de l’Islam.
2- La réponse démocratique.
Cette réponse présente l’avantage d’écarter la coercition et la violence et de s’en remettre au choix démocratique. Mais qu’est ce que le choix démocratique ? C’est l’expression de la volonté populaire, c’est la souveraineté du peuple. C’est l’article 7 de la Constitution brandi par le mouvement populaire contre la présidence à vie de Bouteflika et la perpétuation de l’Etat autoritaire. Et comment constate-t-on la réalité de la souveraineté populaire ? C’est par le vote majoritaire. Ainsi, abandonnant toute tentative de prendre le pouvoir par un coup d’Etat ou une insurrection armée, le parti ou la coalition de partis islamistes s’en remettrait à la souveraineté populaire, à la règle de la majorité pour accéder au gouvernement de la société. Mais abandonnant la voie de la violence pour accéder au pouvoir, ces partis islamistes ont-ils pour autant renié leurs objectifs liberticides à l’encontre des citoyens ne partageant pas leurs vues sectaires, à l’encontre des femmes algériennes aspirant à la vie digne et égale de leurs compatriotes hommes, à l’encontre des citoyens exerçant leur libre arbitre ? Rien ne le garantit. S’en remettre uniquement à la réponse démocratique, c’est considérer la souveraineté populaire comme illimitée et accepter donc par exemple qu’une majorité de 70% lors d’un vote peut légitimer la perte de liberté pour les 30% de la population. Les libertés perdraient alors leur caractère universel. La réponse démocratique parait ainsi insuffisante. Quelques soient les définitions correctives apportées, la possibilité que la démocratie serve à l’instauration d’un autre Etat autoritaire, religieux ou pas, existe. Il a été soutenu que l’expérience de la vie démocratique pourrait servir à une évolution des partis islamistes vers des partis de type « démocrates-chrétiens ». C’est possible, mais pas obligatoire. C’est à un jeu de hasard que l’on se livrerait. La comparaison avec les pays européens souffre de l’abstraction faite du développement de la culture des libertés individuelles avec les courants philosophiques fondateurs des droits de l’homme et de l’affaiblissement de l’Eglise provoqué par la corruption et les réformes protestantes. Telle n’est pas la situation de la religion dans notre pays malgré les ouvertures naissantes mais pas encore suffisamment répandues.
3- La réponse de l’Etat de droit.
L’Etat de droit n’est pas l’Etat appliquant les lois qu’il a promulguées. C’est un raisonnement circulaire. L’Etat fonde les lois, les lois fondent l’Etat. Mais qu’est-ce-qui fonde l’Etat et les lois ? Même cette définition allemande de l’Etat de droit a fini par se référer à un droit fondamental à la base des lois. C’est dans la tradition anglaise des droits de l’homme que l’on retrouve la définition correcte de l’Etat de droit, « the rule of law » que l’on traduit par la suprématie du Droit. Ce droit, ce sont les droits inaliénables définis depuis le 17ème siècle en Angleterre à travers l’habeas corpus en 1689 et repris dans les déclarations universelles des droits de l’homme qui ont suivi. Le Droit, c’est aussi la limitation des pouvoirs de l’Etat et la séparation des pouvoirs. La constitution américaine limite clairement les pouvoirs du Congrès dans la section 8 de son article premier. C’est donc ce Droit inaliénable qui est à la base des lois et des pouvoirs de l’Etat. Les lois votées par un parlement doivent être conformes à ce droit. Un Président, voire un chef d’état-major ne peut décréter qu’un emblème est « une atteinte à l’unité nationale », ni que des opinions tendent à la « démoralisation de l’Armée », ni d’une manière générale que des opinions de citoyens soient subordonnées au prestige des institutions. Le Droit fondateur de l’Etat de droit est le socle qui protège la société de l’arbitraire de l’Etat et de ses abus de pouvoir. La suprématie du Droit, c’est la garantie contre l’instauration d’un Etat autoritaire. Cette suprématie du Droit signifie qu’aucune institution politique représentative, qu’aucun corps constitué comme l’Armée ou les services de sécurité ne peuvent exécuter des ordres contraires à la Constitution. Elle signifie qu’aucun Ministre de la Justice, qu’aucun Magistrat n’est habilité à interpréter des lois dans un sens contraire à la Constitution. C’est cet Etat de droit qui est le rempart contre les éventuelles tentatives de remettre en cause les libertés individuelles ou l’attribution de pouvoirs non prévus par la Constitution à des institutions de l’Etat. C’est aux principes du Droit que devront se soumettre tous les partis politiques toutes tendances confondues et ce sont ces principes qui les rendront légaux et attributaires des droits constitutionnels. C’est dans ce cadre que devra être donné la réponse à la place des Islamistes dans la société civile. Il ne s’agit pas de dispositions discriminatoires mais de règles applicables à tous les partis et courants politiques sans exception aucune.
Le Hirak annonciateur de l’Etat de droit ?
Le Mouvement populaire du 22 Février 2019 a amorcé un élan unitaire dépassant les conflits antérieurs en réunissant les Algériennes et les Algériens aspirant à la démocratie et à la liberté. Il a rassemblé des femmes et des hommes appartenant à des courants politiques et idéologiques différents voire divergents. Qu’est-ce donc qui a pu les unir ? C’est ce dénominateur commun, cette aspiration à la liberté fondatrice d’une société civile équilibrée et dynamique. Ce qui a été construit au cours du Hirak doit être consolidé et aucun débat ne doit exclure cette question fondamentale : qu’est-ce qui doit garantir la paix civile si ce n’est la coexistence pacifique au sein de la société civile et dans la durée de tous les courants d’opinion rejetant la violence. Tous les partis politiques, tous les animateurs et leaders du Hirak, toutes les associations et personnalités attachées à la démocratie et aux libertés ont le devoir de discuter, de se concerter dans la clarté pour que la culture des libertés s’ancre définitivement dans l’Algérie aspirant à une digne place dans le concert des nations.