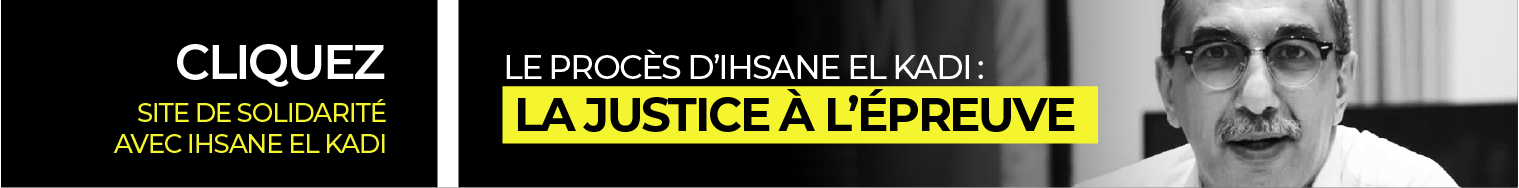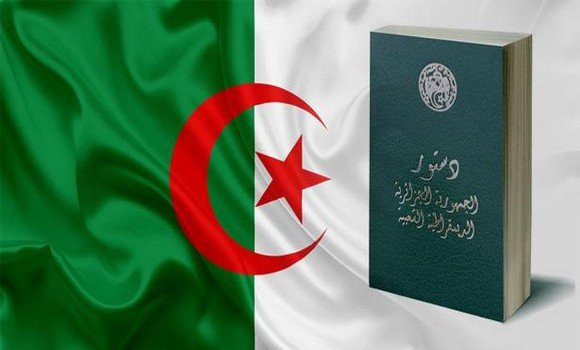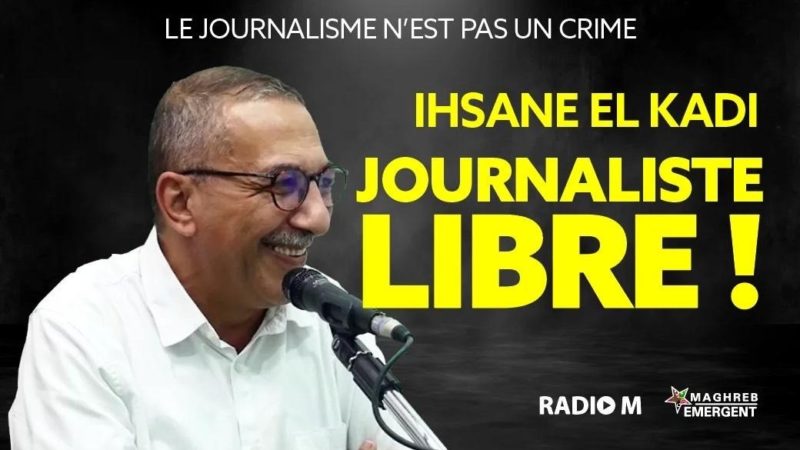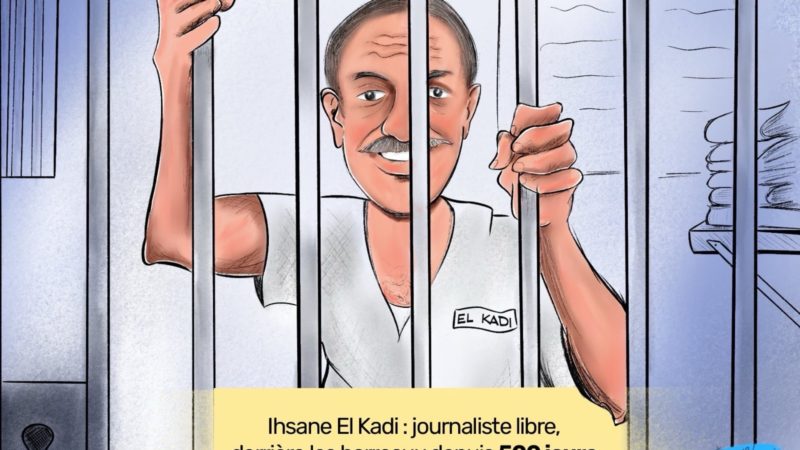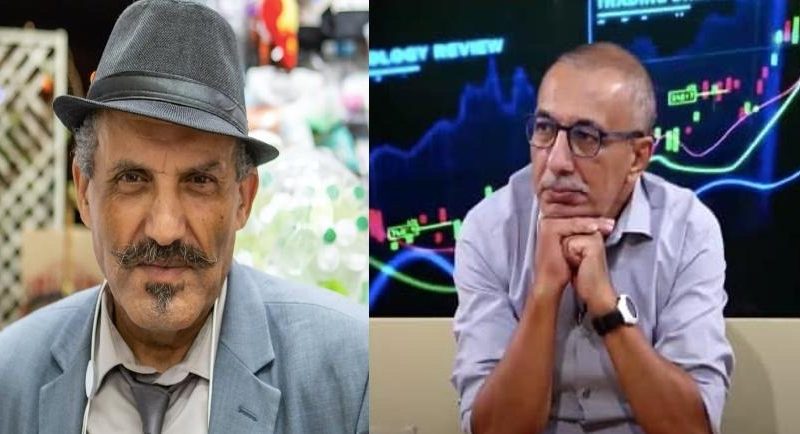L’article 02 du projet de constitution proposée ce mois de mai 2020 reprend les cinq précédentes constitutions et dispose : « L’Islam est la religion de l’Etat». Quelle est la signification de cet article ? Aucune réponse franche n’est donnée. Toute la place est laissée aux sous-entendus. Un Etat peut-il avoir une religion ? Evidemment non. L’Etat est une abstraction, une construction intellectuelle. Il ne peut prononcer la profession de foi (shahada), prier et jeûner. Comme toute religion est affaire d’êtres humains, il reste à se tourner vers les citoyens salariés des administrations et institutions de l’Etat. Sont-ils obligatoirement de confession musulmane ? Si l’on s’en tient aux libertés de conscience et de culte énoncées dans les constitutions, ils ne sont pas astreints formellement à l’être. Seul le Président de la république est obligatoirement de confession musulmane selon l’article 91 du projet. Quelle est alors l’utilité d’une telle disposition ? Dans un pays où 95% ou plus de la population est de confession musulmane, la question est entière.
Un héritage européen et chrétien
Comme l’idée de constitution, la religion d’Etat est une notion d’origine européenne. Quand en 380 de notre ère la Chrétienté devient religion officielle de l’empire romain, les autres cultes sont interdits. Autrement dit, la Chrétienté devient la seule religion de la population de l’empire romain. Ainsi, les libertés de conscience et de culte sont ignorées et niées. Il s’ensuit une répression féroce contre le paganisme dominant alors. C’est donc une religion unique qui est imposée. Peut-on retenir une telle signification pour l’Algérie de 2020 ? Pas totalement. La Constitution garantit en théorie les libertés individuelles. Par conséquent, toujours en théorie, les citoyens algériens sont libres de choisir leur religion. Mais dans leur vie quotidienne, ils subissent les pressions, les tracasseries voire la répression de l’Etat et de cercles religieux qui n’admettent pas dans les faits les libertés de conscience et de culte. Faut-il conclure que l’article 02 de la Constitution légitime l’intolérance ? Il y contribue certainement en ne dévoilant pas clairement et ouvertement son champ d’application. Pour découvrir le sous-entendu porté par cet article, continuons de suivre l’évolution des relations Etat-religion sur le continent européen.
Jusqu’à la fin du 15ème siècle, la Chrétienté s’étend à toute l’Europe occidentale dans sa version catholique. L’Europe de l’Est et le bassin oriental de la Méditerranée sont couverts par l’Eglise orthodoxe issue du schisme qui s’est produit dans la Chrétienté au 11ème siècle. Ce schisme est reconnu comme tel par l’Eglise romaine et le Pape et ne donne pas lieu à des conflits majeurs. C’est à partir du 16ème siècle que les problèmes religieux vont empoisonner la vie des pays européens. Au cours de la première moitié du 16ème siècle, un mouvement de réforme impulsé principalement par Martin Luther et Jean Calvin provoquera ce que l’Eglise catholique qualifie d’hérésie. Des courants protestants vont se séparer du catholicisme et du Pape et se propager dans toute l’Europe occidentale. Ce nouveau schisme non reconnu comme tel par le Pape remet en cause la religion unique et dessine une nouvelle implantation des courants religieux. Il s’ensuit des rivalités qui affectent la vie interne des pays européens et les relations entre ces pays. La France connait huit (08) guerres de religion au cours de la deuxième moitié du 16ème siècle. A l’échelle européenne, la « guerre de trente ans » de 1618 à 1648 opposent pays protestants regroupés autour de la Suède et la coalition catholique dirigée par l’Espagne et l’Autriche. Au cœur de cette guerre se trouve le « Saint-Empire romain germanique » composé de plus de 350 entités politiques, des Etats princiers et des « villes libres » qui sont partagés entre catholicisme et protestantisme. Les Traités de Westphalie de 1648 qui mettent fin à cette guerre établissent le principe de « la religion d’Etat » qui est déterminée par celle du souverain. La paix put ainsi être rétablie. La Suisse et la Hollande gagnent leur indépendance. De nombreux historiens considèrent ce moment comme l’acte de naissance de l’Etat-Nation. Il annonce la dissolution du « Saint-Empire romain germanique » qui interviendra en 1806.
Un héritage devenu obsolète
L’histoire de l’Europe ne s’arrête pas aux Traités de Westphalie de 1648. L’Europe va continuer à faire évoluer les relations entre l’Etat et la religion. Dès 1689, par l’Habeas Corpus, l’Angleterre pose les fondements des droits de l’homme. Les Européens partis s’établir dans la nouvelle Amérique fondent en 1776 les Etats-Unis où prédominent liberté et diversité religieuses. C’est la première séparation de l’Eglise et de l’Etat. A la suite de la philosophie des lumières qui l’annonce, la Révolution française de 1789 proclame la déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. Dans leur ensemble, les pays européens tendent vers plus de tolérance et de liberté, conditions pour préserver la paix et l’ordre intérieur. La religion d’Etat devient un vieux souvenir relégué aux archives. C’est l’avènement généralisé de l’Etat de droit, des libertés individuelles et de la démocratie. La croissance économique, le bien être social et l’essor culturel trouvent leur pleine expression.
Pourquoi cet attachement à un héritage désuet ?
Ainsi, le principe d’une religion d’Etat qui traduit la soumission des sujets d’un Etat à leur Souverain, ne correspond plus aux exigences de l’ère moderne. Il devient désuet parce qu’il est un obstacle à l’établissement de la liberté religieuse, de la liberté de conscience et de culte. Les pays européens qui ont tardé à supprimer cette disposition sont à l’exemple de la Norvège, des royaumes. Mais la liberté religieuse était très tôt reconnue et telle une peau de lézard, la religion d’Etat tomba d’elle-même. Alors que signifie l’entêtement à maintenir dans la Constitution de « la République algérienne démocratique et populaire » un principe d’un autre temps. Pourtant, les constitutions proclament l’adhésion de l’Algérie à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 et au Pacte international des droits civils et politiques de 1966, deux documents adoptés par l’Assemblée générale des Nations-unies. Pourtant, les constitutions algériennes reconnaissent et garantissent les libertés de conscience et de culte. Sommes-nous en présence d’une menace imminente qui éradiquerait l’Islam en tant que religion dominante en Algérie ? Les citoyens attachés à leur religion et qui dépassent les 95% de la population risquent-ils de céder à des appels à l’abjuration et à l’apostasie ? Qu’est-ce qui explique alors la survivance et la prédominance de l’Islam après 130 années de colonisation française ? L’explication se trouve hélas dans une volonté renouvelée depuis l’Indépendance de s’opposer à la libre pensée. Elle se trouve dans la volonté de « caporaliser » la pensée des citoyens. Elle se trouve dans la volonté de s’opposer à l’épanouissement spirituel et intellectuel des Algériennes et des Algériens. Elle se trouve dans l’objectif avoué de maintenir un Etat autoritaire. Pour l’avènement d’un Etat de droit, l’Algérie doit dénoncer le Traité de Westphalie de 1648 !