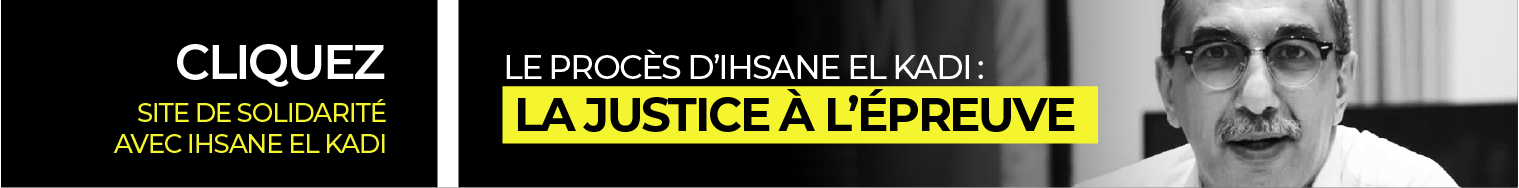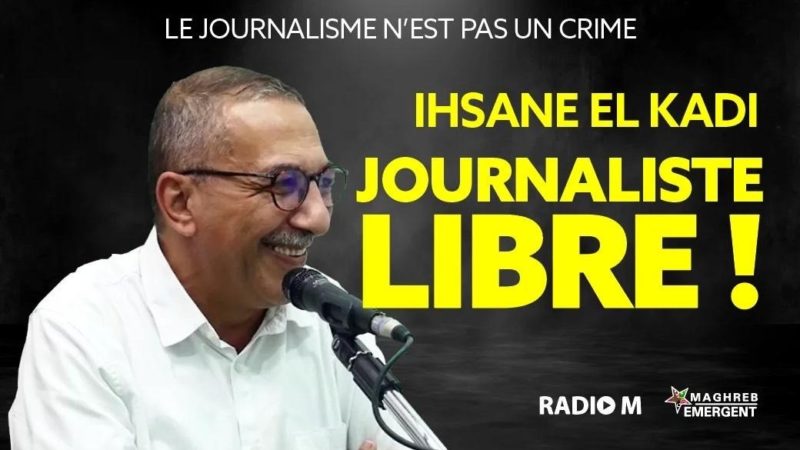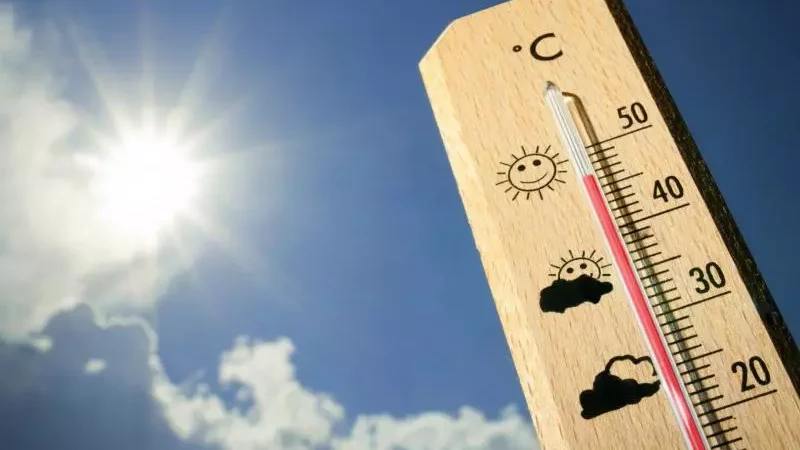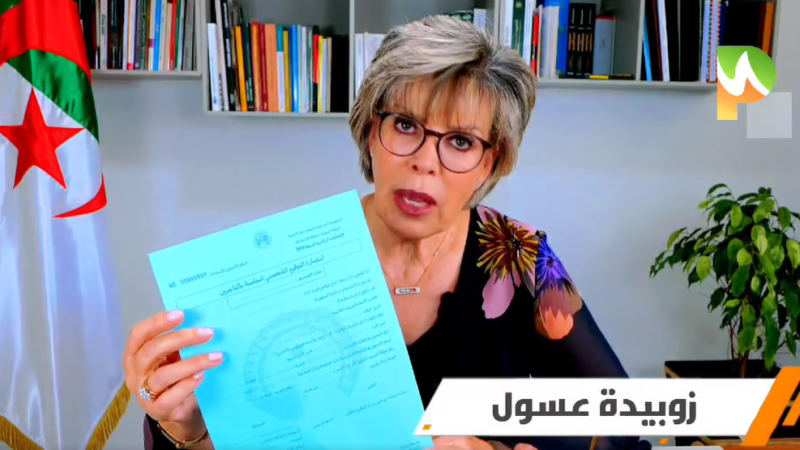La présentation lundi des deux projets de loi sur la presse écrite, numérique et audiovisuelle, intervient de manière opportune alors que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains, Mary Lawlor, effectue depuis le 26 novembre une visite officielle en Algérie.
Derrière ces textes, la mesure phare réside dans l’abrogation des peines privatives de liberté visant les journalistes, suite aux précédentes dénonciations onusiennes sur la répression contre les médias. Cette annonce du ministre de la Communication Mohamed Laagab prend des allures de petite révolution pour le secteur des médias en Algérie.
En effet, depuis l’avènement du Hirak début 2019, un nombre conséquent de journalistes se sont retrouvés derrière les barreaux au seul motif d’avoir exprimé des opinions dissidentes.
Au-delà des cas emblématiques de Rabah Kareche, Mohamed Mouloudj, Khaled Drareni , ihsane el kadi ou Saïd Boudour, d’autres journalistes comme Merzoug Touati et Hassan Bouras, ont également subi le joug de la censure. Sans oublier Mustapha Bendjama, journaliste emprisonné à l’heure actuelle, victime de cette répression généralisée piétinant allègrement les libertés fondamentales.
Mais l’apogée de cette campagne visant à bâillonner toute presse libre reste sans conteste la lourde peine de 5 ans de détention prononcée récemment contre le Directeur du groupe Interface-médias, Ihsane El-Kadi, devenu malgré lui le porte-étendard d’un journalisme critique en sursis face à l’arbitraire des autorités algériennes.
Les grandes lignes des projets de loi Laagab
Outre l’abrogation des peines privatives de liberté, ces projets de loi visent globalement, selon les termes employés par Mohamed Laagab ce lundi devant le Conseil de la nation, à « combler les lacunes » du paysage médiatique national et à « édifier un système robuste ».
Côté économique, l’instauration d’un simple régime déclaratif facilitera la création de nouveaux médias. Même les organisations politiques et syndicales se verront autorisées à posséder leurs propres organes de publication, gage d’un pluralisme accru.
Côté régulation, deux instances de médiation indépendantes, l’une dévolue à la presse papier et l’autre au secteur audiovisuel, régleront les litiges éventuels. De quoi désengorger efficacement les tribunaux en évitant l’écueil de longs procès coûteux. Un conseil de déontologie veillera par ailleurs au respect des règles éthiques par les journalistes.
Enfin, sur le plan social cette fois, directeurs de publication et rédacteurs en chef devront dorénavant justifier d’un diplôme universitaire ainsi que d’une expérience professionnelle de 8 ans. La diffusion d’œuvres nationales sera également imposée à hauteur de 60 % du volume horaire sur les chaînes de télévision locales.
Des zones d’ombre demeurent certes sur la fiscalité des médias ou les salaires minimums des journalistes. Tout comme la protection des systèmes informatiques interroge face aux risques de cyberattaques.