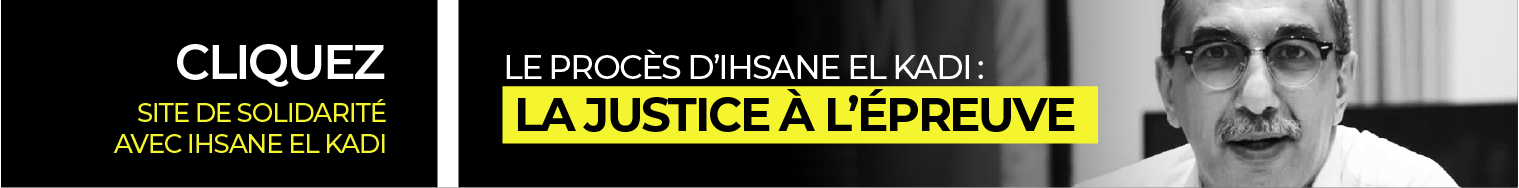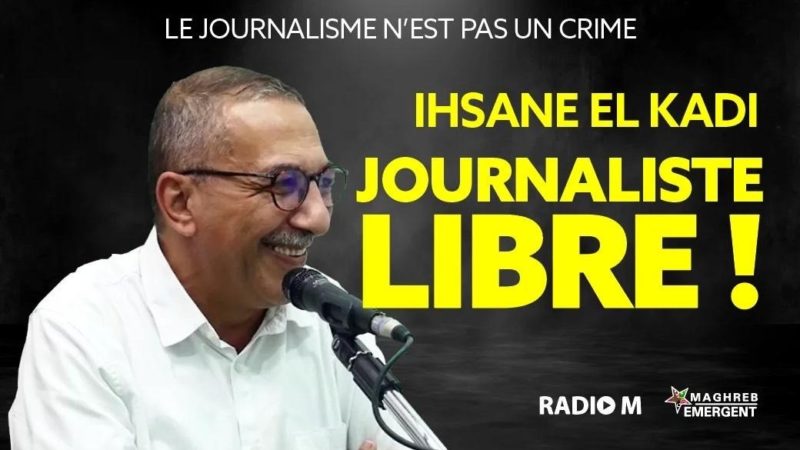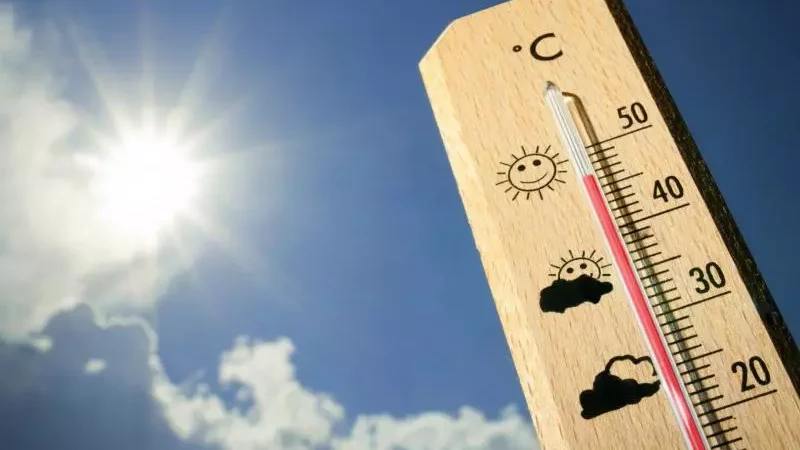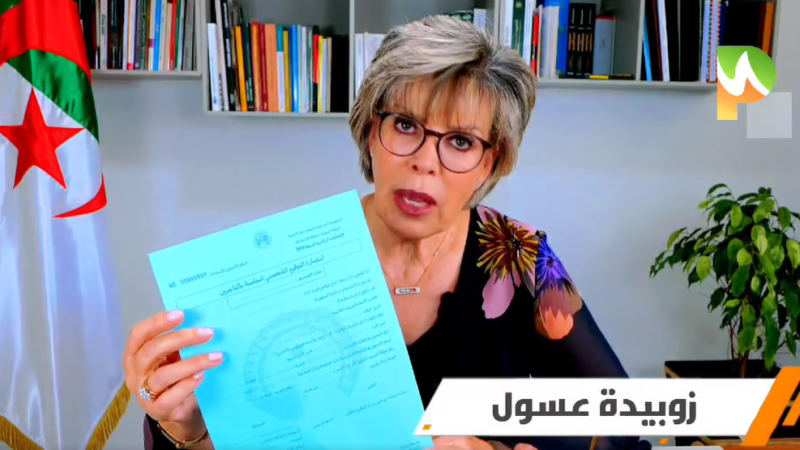Attendant des actes concrets sur la question des journalistes emprisonnés, Mary Lawlor arrive dans un contexte tendu entre discours lénifiants et réalité du terrain toujours inquiétante.
Attendue de pied ferme par les défenseurs des droits humains en Algérie, Mary Lawlor a entamé le 26 novembre une visite officielle de deux semaines dans le pays. Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, elle compte approfondir sa compréhension de certains dossiers sensibles, dont la liberté d’expression et la persécution de journalistes indépendants.
Son passage au ministère de la Communication le 27 novembre aura permis au gouvernement de mettre en exergue les avancées du nouvel arsenal juridique encadrant les médias. Des textes dépeints comme progressistes pour la liberté de la presse par le ministre Mohamed Laagab. Cependant, la réalité du terrain semble s’inscrire en faux contre ce satisfecit.
Deux affaires retentissantes jettent une lumière crue sur les libertés bien relatives dont jouissent les journalistes dans le pays : les récentes condamnations d’Ihsane El Kadi et Mustapha Bendjama. Le premier vient de voir la Cour suprême entériner deux sévères condamnations à son encontre. Les motivations spécieuses avancées dans l’une des deux affaires sont une prétendue « atteinte à l’unité nationale », sur la base d’un article de presse, bien qu’il soit théoriquement protégé par l’article 54 de la constitution.
Dans la seconde, il a écopé de cinq années d’emprisonnement ferme pour un soi-disant« financement étranger ». Parallèlement, une amende d’un milliard de centimes a été prononcée à l’encontre d’Interface Médias, la société fondée par le journaliste qui édite les sites d’information Radio-M et Maghreb Émergent. Ces derniers sont placés sous scellés depuis 24 décembre 2022.
Quant au second, déjà emprisonné depuis février 2023, il a écopé début octobre de 8 mois ferme dans une affaire de « réception de fonds auprès des institutions étrangères ou intérieures dans l’intention de commettre des actes qui pourraient atteindre à l’ordre public » et de « diffusion d’informations et de documents (…) dont le contenu est classé partiellement ou intégralement secret », puis début novembre à 6 mois supplémentaires pour « immigration clandestine » et « association de malfaiteurs ».
Ces sentences arbitraires, qui criminalisent en réalité un journalisme libre et indépendant, contrastent singulièrement avec l’embellie dépeinte par les autorités dans la sphère médiatique. Difficile dans ces conditions de croire à une réelle amélioration de la situation sur le terrain.
La visite de Mary permettra-t-elle d’infléchir la position des autorités ? On peut légitimement s’interroger, même si les affaires judiciaires ne relèvent pas directement du ministère de la Communication.
Si le dialogue est important, encore faut-il qu’il soit suivi d’actes concrets. La réalité du terrain en Algérie semble malheureusement indiquer que les lignes peinent encore à bouger sur la question des droits et des libertés fondamentaux des journalistes. Une situation préoccupante qui jette une ombre sur les discours officiels vantant le progrès démocratique. Affaire à suivre donc ces prochaines semaines.