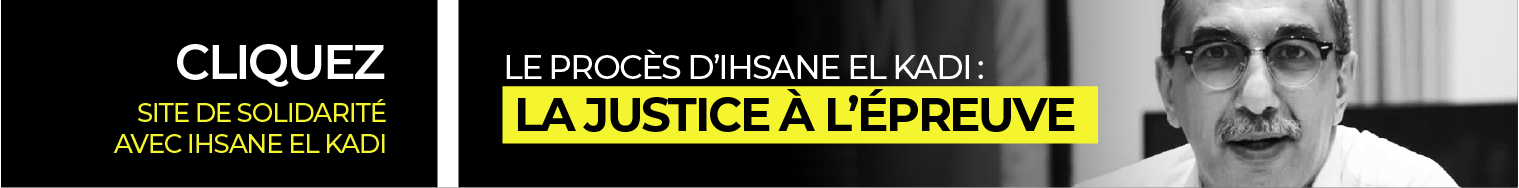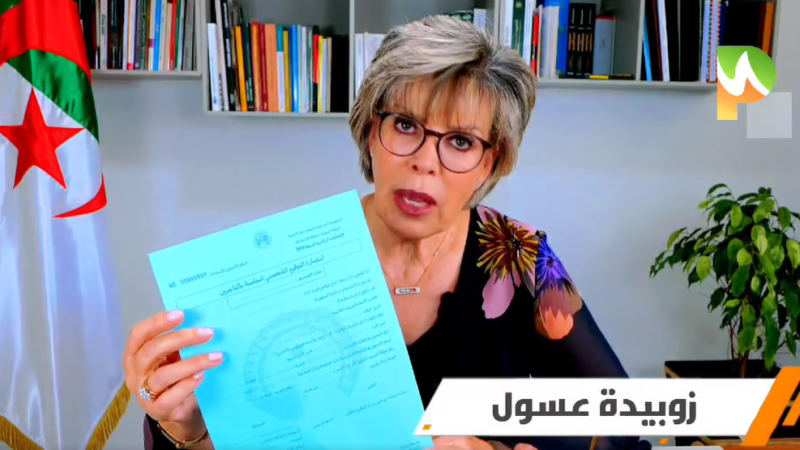Ammar Belhimer, ministre de la Communication, déclare vouloir lancer « une réforme globale » dans le secteur de la presse. Il a évoqué, lors d’une visite, samedi 11 janvier, aux Maisons de la presse Tahar Djaout et Abdelkader Safir, à Alger, l’ouverture de chantiers sur base d’un dialogue avec les professionnels des médias. Il a suggéré que la loi sur l’information sera révisée. Durant ces dernières années, le secteur de la presse a été abandonné, à la faveur de l’absence totale d’une politique d’Etat sur la communication et des limites politiques à la liberté d’expression. Journaliste et universitaire, Amar Belhimer connait bien le secteur. Les chantiers qu’il doit ouvrir sont nombreux.
Donner un statut légal aux chaînes de télévision privées
La loi sur les activités audiovisuelles a été adoptée en janvier 2014, mais jamais suivie de textes d’application. Elle est restée muette. La loi, qui devait donc régulariser le secteur de la télévision et qui n’a autorisé l’existence que de « chaînes thématiques », n’a pas été mise en application et les chaînes privées algériennes, lancées à partir de 2013, sont demeurées sans statut légal. L’Etat n’a reconnu l’existence que de cinq chaînes privées : Echourouk TV, El Djazairia, Ennahar TV, Dzair TV et Hoggar TV. Ces chaines, considérées comme étrangères, ont obtenu l’agrément de « bureaux accrédités à Alger ». Les autres chaînes, crées depuis, n’ont rien eu. En mars 2015, l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV), péniblement installée, a évoqué la possibilité d’enquêter sur les « sources de financement » des chaînes privées, mais rien n’a été entrepris. Le flou demeure entier sur le payement des services satellite notamment.
Autoriser le lancement des radios privées
La loi sur les activités audiovisuelles autorise l’existence de service de radiodiffusion privée sous certaines conditions légales et techniques. Mais, jusqu’à présent, aucune mesure concrète n’a été engagée pour permettre l’existence sur les fréquences de radios privées algériennes. L’Etat continue d’exercer un monopole entier sur les radios et sur les fréquences.
Rendre fonctionnelles les autorités de de régulation
Créé en septembre 2015 et installée officiellement en juin 2016, l’Autorité de régulation de l’Audiovisuelle (ARAV) n’a, en réalité, jamais fonctionné. Dépourvues de réelles prérogatives et non autonomes sur le plan financier, l’ARAV ne pouvait pas exercer « une autorité » sur des chaînes privées algériennes non reconnues par l’Etat ni sur le secteur public d’ailleurs livré à d’autres tutelles. De plus, aucun représentant du secteur privé ne fait partie de la composante de l’ARAV qui reste « ligotée » faute de moyens et de « volonté politique » de régulariser le domaine audiovisuel. Prévue dans la loi sur l’information de 2012, l’Autorité de régulation de la presse écrite n’a jamais été mise en place. Idem pour le Conseil supérieur de l’éthique et de la déontologie du journaliste. Sur les 17 textes d’application relatifs à la loi sur l’information, seuls 4 ont été promulgués.
Doter les médias électroniques d’un statut
Les médias électroniques n’ont toujours pas de statut et ne sont pas reconnus en tant que tels en Algérie.
Pourtant, la loi sur l’information de 2012 a consacré 6 articles à la presse électronique et aux services audiovisuels en ligne. Les journalistes qui exercent dans les médias électroniques n’ont aucune protection mis à part ce qui est prévu dans la législation de travail. Et, parfois, ces journalistes sont assimilés à des bloggeurs y compris lorsqu’ils sont cités à comparaître devant les juges.
Soutenir la presse écrite
Le rétrécissement de l’activité économique, les limites imposées à la liberté d’expression et les coûts de production ont considérablement affaibli la presse écrite en Algérie. La forte concurrence des médias électroniques et des télévisions privées a réduit le champ du lectorat. Des grands titres sont menacés de disparition alors que des journaux à faible audience bénéficient de publicité publique en contrepartie du soutien aux choix politiques du gouvernement. L’Etat, par devoir, peut appuyer les journaux sans interférer dans leurs gestions rédactionnelles. Imposer un seuil minimal de tirage pour pouvoir bénéficier de la publicité publique paraît être inévitable pour limiter l’anarchie actuelle avec l’existence de journaux qui ne sont même pas distribués. La gestion de l’ANEP en matière de distribution de la réclame publique doit devenir transparente avec publication de bilans périodiques et précisions des paramètres retenus. L’appui de l’Etat peut être utile dans la distribution de la presse et dans l’impression, selon des règles, claires.
Assainissement de la situation des imprimeries publiques
Les imprimeries publiques sont dans une mauvaise situation économique, pas loin du dépôt de bilans. C’est notamment le cas des imprimeries de Béchar et de Ouargla. Cela est la conséquence de la chute drastique des tirages des journaux ces dernières années et du non payement des dettes par plusieurs journaux. Certains titres ont cessé de paraître sans payer leurs factures cumulées aux imprimeurs. Comment récupérer l’argent perdu ? L’Etat doit-il encore posséder des imprimeries de journaux ? C’est une question à laquelle il faudra répondre aussi.
Promulguer une loi sur la publicité
Le marché de la publicité fonctionne sans règles en Algérie. L’accès des médias à la réclame publique n’obéit à aucun critère précis. Et la distribution de la publicité publique ne se fait pas selon les règles professionnelles. L’opacité y est totale. Le rapport entre annonceurs et supports pèse parfois sur les contenus éditoriaux des médias. Les recettes publicitaires des médias ne font pas l’objet de publication. Ne faudra-t-il pas revoir le monopole de l’Etat sur la publicité publique ? Dans tous les cas, une loi sur la publicité qui règlemente et qui clarifie la situation est indispensable.
Lever les contraintes sur les médias publics
La télévision et la radio publiques subissent des pressions continuelles pour orienter leurs contenus informatifs. La notion de service public et le droit du citoyen à l’information ne sont pas respectés. Lever toutes les contraintes sur les médias publics est inévitable, sinon ils risquent de perdre totalement leur influence et leur présence dans une scène médiatique concurrentielle. La gestion de l’ex-RTA doit être également revue pour appliquer les règles universellement admises et rationnaliser les dépenses. Un audit global est nécessaire.
Protéger les journalistes avec un statut
Les journalistes algériens sont toujours sans statut. Ils sont à la merci des employeurs qui les exploitent parfois et qui ne leurs assurent pas leurs droits sociaux (déclaration à la sécurité sociale notamment). La commission nationale provisoire de la délivrance des cartes de presse, crée par le ministère de la Communication, a cessé d’exister. Si un journaliste quitte une entreprise de presse, il est obligé de remettre sa carte professionnelle. Il doit chercher un autre poste d’emploi sans avoir de carte donc d’identité professionnelle. Les correspondants de presse sont, eux, dans une situation plus vulnérable n’étant pas du tout protégés.
Réactiver le fonds d’aide à la presse
Le fond d’aide à la presse a été gelé en 2005 sur décision politique. En 2012, le Fonds, qui était doté à l’époque de 40 milliards de centimes, a été réactivé. Il a fallu attendre 2014 pour qu’un décret fixe la composition de la commission « spécialisée » qui devait décider des modalités d’aide de l’Etat aux médias pour notamment « la formation et le perfectionnement » des journalistes. La commission n’a pas été installée et le fonds est resté bloqué. En février 2018, l’ancien ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a parlé de « le reconstitution » de ce fonds. A ce jour, l’argent, mis dans un compte d’affectation spéciale, n’a pas été utilisé.