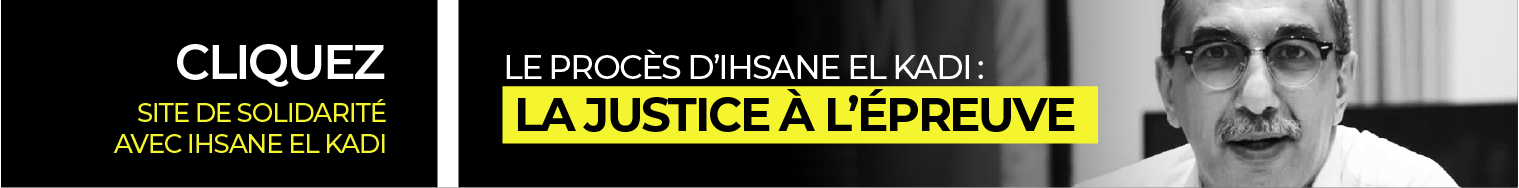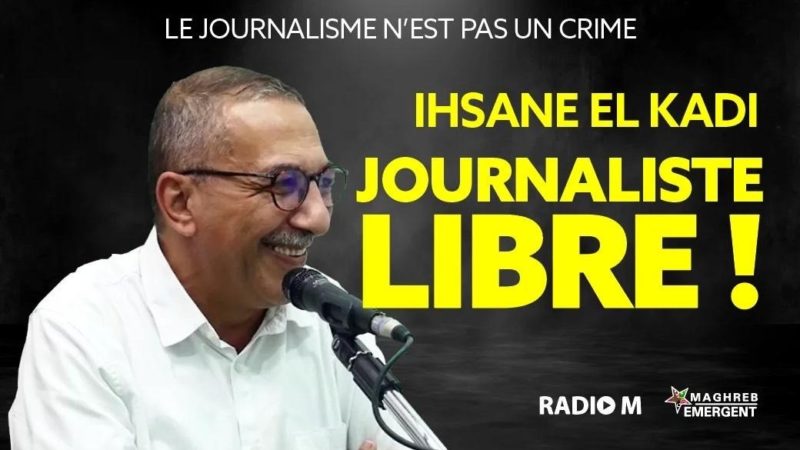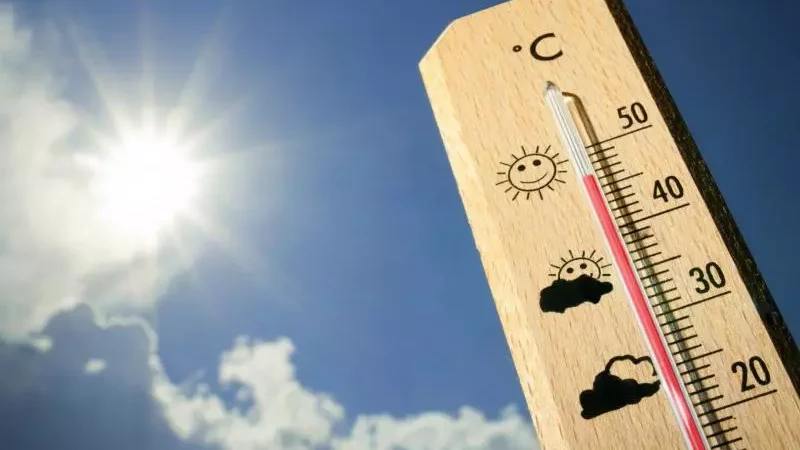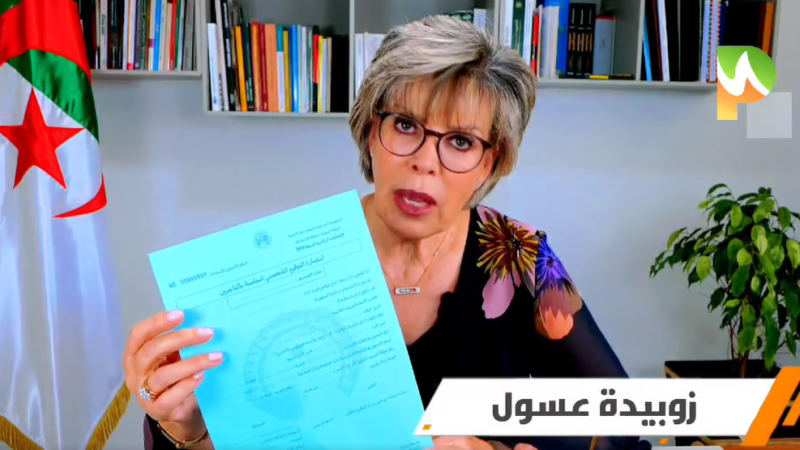Le journaliste Mohamed Mouloudj, qui a œuvré une grande partie de sa carrière pour le défunt quotidien Liberté, verra son procès en appel s’ouvrir le 11 février 2024.
Incarcéré pendant 13 mois suite à son placement en détention provisoire le 14 septembre 2021, il a été condamné en première instance à deux ans de prison dont un ferme, pour « atteinte à la sûreté de l’État ».
Les démêlés de Mohamed Mouloudj avec la justice algérienne découlent d’un SMS adressé le 27 avril 2021 à Ferhat Mehenni, dirigeant du Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK).
Dans ce message, le journaliste sollicitait un entretien avec M. Mehenni pour les colonnes de Liberté. Quelques semaines plus tard, le Haut Conseil de sécurité algérien classait le MAK comme « organisation terroriste ».
Instrumentalisant ce SMS anodin, le parquet a argué qu’il constituait une preuve d’appartenance du journaliste à une organisation terroriste, accusation qui n’a finalement pas été retenue. Néanmoins, envoyer un message au leader d’un mouvement rebelle aurait, selon la justice, porté atteinte à la sûreté de l’État.
Or, la missive électronique a été transmise avant la mise à l’index du MAK, contrevenant ainsi au principe universel de non-rétroactivité des lois. Surtout, la Constitution algérienne stipule clairement que les journalistes ne peuvent être punis d’une peine privative de liberté pour leurs écrits.
La répression s’abat également sur d’autres professionnels des médias, tels Saïd Boudour et Jamila Loukil. Tous deux ont été accusés de « complot contre la sécurité de l’État » et d’« appartenance à une organisation terroriste».
Cependant, après plus de 30 mois de pressions et d’intimidations, ils ont finalement été acquittés dimanche dernier par le tribunal criminel de Dar El Beida.