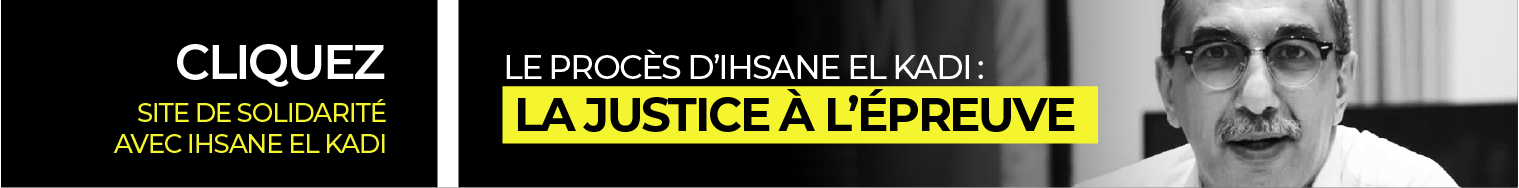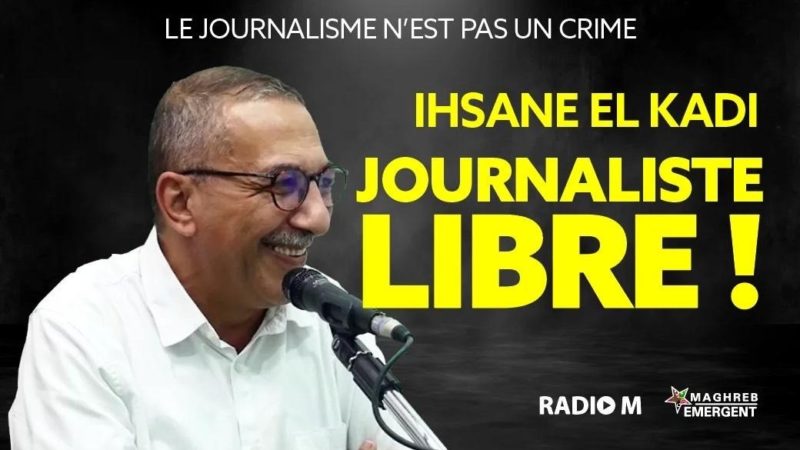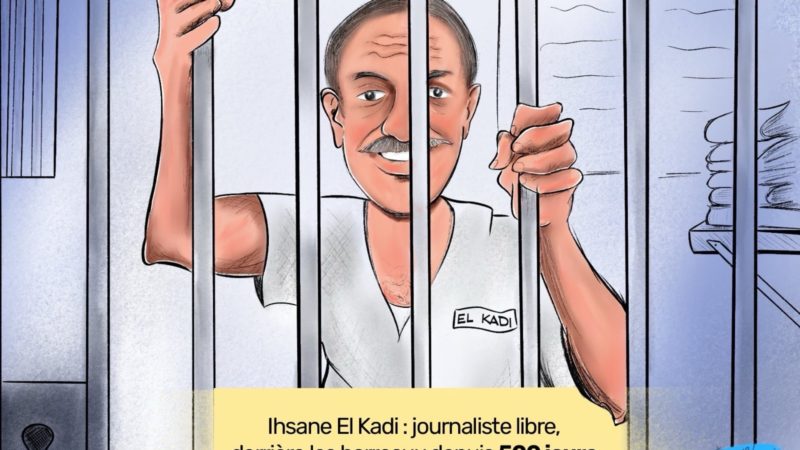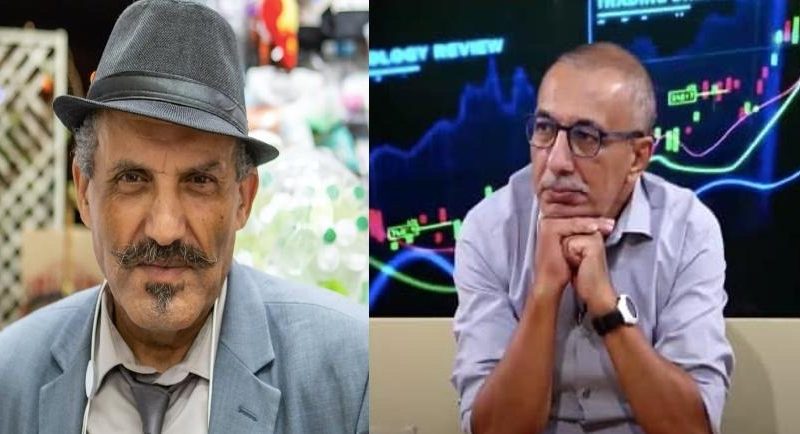0. Il nous paraît nécessaire d’aborder notre présentation en proposant une première définition de l’évènement qui commence en février 2019 en Algérie. Nécessaire parce qu’une discussion réelle, et éventuellement utile, ne peut avoir lieu sans un entendement commun partagé par les protagonistes à la discussion, a fortiori lorsqu’une telle discussion a pour objet un événement historique inédit, et que, de plus, cet événement est une révolution. Une révolution, quelle que soit sa nature, son lieu, son époque, sa durée ou son ampleur, est toujours une lutte ininterrompue sur le sens des mots ; aussi bien sur le sens des mots qui forment les discours, les notions, les concepts de la révolution, que des mots (souvent les mêmes) de la contre-révolution. Il peut arriver que les mots, comme ceux qui les portent, changent d’avis, ou changent de camp. Il peut arriver que les mots trahissent la faiblesse des discours ou celle des combattants, ou, au contraire, qu’ils les transportent vers des contrées inespérées de la pensée et de l’action. Prenons le cas du mot irradiant, du mot central à l’évènement qui nous concerne : Hirak. C’est un mot qui s’est rapidement imposé dans le discours des uns et des autres. Il a été repris parfois avec des qualifications telles que «populaire» (Hirak populaire) ou même, fameusement, «soi-disant» (soi-disant Hirak). A travers plus de 11 mois de pérégrinations dans les conversations, les discussions, les discours et les écrits, le mot s’est installé dans le paysage national avec les atours princiers d’une indétrônable évidence. Pourtant, à y regarder de plus près, on constate que la multiplicité des interprétations auxquelles il peut donner lieu, permet aux différents protagonistes de la révolution de février d’en faire un usage particulier, subordonné et conforme à leur vision des choses. Hirak, en arabe maghrébin, signifie «mouvement» au sens générique du mot. Dans le contexte complexe, et inédit, dans lequel nous évoluons actuellement, Hirak a été entendu, à une extrémité du spectre du débat politique, comme mouvement quasi-brownien, mouvement spontané, contradictoire, d’une population animée par des instincts, des pulsions, des désirs, des idées, des projets, des idéologies contradictoires. Une population en révolte contre l’autorité, contre le régime, contre la corruption ou l’injustice. Qu’il soit enrobé de connotations positives (Hirak joyeux, généreux, festif…) ou, au contraire, péjoratives (Hirak incapable de s’organiser, de se structurer, de se donner des représentants ou une direction…), le « Hirak » est ici perçu comme un phénomène social ou politique consistant essentiellement en une masse populaire mise en branle, on ne sait comment, même si diverses hypothèses fleurissent ici et là selon les circonstances (on a même entendu et lu que le Hirak était apparu «miraculeusement»), mais sans objectif ni stratégie, une sorte d’énergie parvenue à l’air libre, en combustion, jusqu’à son inéluctable épuisement. A l’autre extrémité du spectre des interprétations, le hirak est entendu comme mouvement populaire, mouvement politique, doué d’une volonté collective tendue vers la réalisation d’un objectif commun : la fin du régime actuel. Dans cette interprétation, le hirak n’est plus un simple mouvement, mais un mouvement qui se déploie dans une direction déterminée consciemment. Au milieu du spectre des interprétations, il y a aussi cette incursion poétique provoquée par la proximité sonore de « hirak » et « hariq », incendie en arabe, et qui a pu donner lieu à, notamment, deux réactions, jumelles en un sens : une réaction de malaise, lorsque le rapprochement des deux mots crée une ambiguïté quant à une implicite nature violente de l’incendie, contenue et cachée dans le hirak algérien, qui se présente pour ce qu’il est pourtant, un mouvement résolument pacifique. A côté de la réaction de malaise, il y a, produite par la même proximité sonore des deux mots, une réaction de jubilation, qui associe la volonté politique du hirak de mettre fin aux turpitudes du régime, à l’effet purificateur, indomptable et puissant, du feu. Les différentes interprétations du mot hirak s’inscrivent donc dans des discours non seulement différents, mais qui, en réalité, s’affrontent durement dans la définition de l’enjeu, de la nature et de l’issue projetée de la lutte en cours. En effet, l’émergence du mouvement populaire du 22 février, réduite à une révolte, particulière, et de grande ampleur, certes, mais une révolte tout de même, conduiraient les protagonistes, le régime en particulier, à la considérer et à la traiter en tant que telle, c’est-à-dire comme l’expression d’une colère puissante, mais, par nature, promise à son extinction à plus ou moins long terme. Par contre, le hirak, conçu comme mouvement populaire politique conscient, ne peut être réduit à une révolte, mais, compris comme une révolution. C’est de ce point de vue que je me place, et ce, pour les raisons suivantes :
1. La révolution de février est une insurrection morale. Car, parmi la foison des causes de la révolution de février, il y a le niveau d’intolérance atteint par la conscience des Algériens lorsqu’ils ont été confrontés à la décision du régime de faire effectuer un 5ème mandat présidentiel à Abdelaziz Bouteflika. Et ce, après 20 ans d’un règne catastrophique, inauguré avec l’escamotage d’une véritable solution de la guerre intérieure des années 1990 qui a manqué d’emporter la société et l’Etat algériens, et conclu par la généralisation de la corruption qui, 20 ans plus tard, a bien failli achever l’entreprise de destruction de la guerre intérieure. Plus qu’une réaction citoyenne ou politique, c’est une remontée massive de la rancœur ressentie durant des décennies contre un régime qui, sous différentes formes, a méprisé le peuple, en le réduisant à une masse d’incapables, d’irresponsables, d’assistés influençables, manipulables, corruptibles, qui a poussé les Algériens à sortir dans les rues à travers tout le pays, en masse, mais, à la surprise générale, c’était là une masse consciente, volontaire, organisée, démontrant par la même que le peuple algérien, en état de profonde révolte, en éruption de profonde colère, ne succombait pas pour autant à la colère ou au dégoût qu’il éprouvait depuis si longtemps, puisque dès le premier jour et, jusqu’à aujourd’hui, durant près d’un an, il a fait preuve d’une parfaite maîtrise de soi, ainsi que d’une intelligence tactique et stratégique, elle aussi surprenante eu égard aux traumatismes violents subis par les Algériens, génération après génération, une intelligence historique qui lui a permis d’inventer ce que l’on a pu être en droit de qualifier dès ses premières semaines, de révolution populaire démocratique pacifique du peuple algérien. Même si cette révolution ne peut être qualifiée, à l’heure actuelle en tout cas, de «révolution morale», il n’en demeure pas moins qu’un de ses principaux ressorts est d’ordre moral, car, en outre ce que nous venons de dire à propos du « déclenchement de la révolution », il faut souligner ici qu’un des thèmes, un thème central, autour duquel s’est mobilisé le peuple de février, c’est celui de la corruption. Le slogan « Klitou leblad ya serrakine ! » résume à lui seul, les dimensions économiques, politiques et morales, de l’insurrection des Algériens. Une insurrection contre la corruption, économique, politique et morale, qui était devenue la caractéristique la plus importante aux yeux des citoyennes et des citoyens des turpitudes et de l’incapacité du régime à faire face aux problèmes du pays ou à gagner un minimum de crédibilité du point de vue des Algériens. Au cours de la première année de la révolution, son caractère moral s’est affirmé de diverses manières qu’ici nous nous limiterons à citer : le respect des femmes, la résistance à l’épreuve physique du Ramadhan, de la chaleur en été, du froid en hiver, la maîtrise de soi face aux provocations et aux violences policières, la constance et la persistance face à la surdité du régime, le courage et la dignité du comportement des détenus et de leurs familles, la générosité populaire autour des manifestants, l’expression des sentiments de solidarité, de fraternité, d’amour…
2. Le mouvement populaire est un mouvement de libération. Car parmi ses effets les plus significatifs, et ceci est à relier à la dimension morale de la révolution en cours, le mouvement populaire s’est de facto constitué en entité sociale, politique, intellectuelle. Le mouvement populaire s’est en effet affirmé comme la force politique principale en dévoilant, par son apparition même, la vacuité et la profonde indigence du champ politique et intellectuel algérien, et, notamment, le caractère fictif des «institutions» qui occupaient (et continuent d’occuper) l’espace et les discours nationaux. Comme bon nombre de régimes similaires, le régime algérien s’est doté de l’arsenal de toutes les apparences d’un Etat moderne : Constitution, Parlement, Présidence de la république, Gouvernement, Justice, Adhésion à diverses conventions internationales, Associations de la « société civile », Partis politiques, Médias publics et privés, Banques, Organismes de lutte contre la corruption ou de défense des droits de l’Homme, etc. Sauf que tout cet attirail est, précisément, fictif. Car un Etat, c’est des institutions, les institutions, c’est des règles qui s’appliquent à tous de la même façon. Or le régime, s’il tient aux apparences, s’est avéré incapable d’en faire une réalité. La révolution en cours permet aux Algériens de se libérer progressivement de la mystification du régime, en exigeant de plus en plus clairement leur besoin d’institutions démocratiques et efficaces, autrement dit leur besoin d’Etat. C’est le mouvement populaire, en les libérant du poids des mensonges structurels de la culture politique d’un régime rentier, autoritariste, corrupteur et aliénant, qui est en train de permettre aux Algériens d’accéder à un niveau supérieur de leur identité citoyenne, à percevoir d’une nouvelle façon leur responsabilité politique par rapport aux enjeux actuels et futurs de l’Etat et de la société.
3. Pourquoi la question de la légitimité est-elle fondamentale ? D’emblée, le mouvement populaire a placé au cœur de sa revendication la question de la légitimité ; légitimité du pouvoir, légitimité de la représentation, légitimité des institutions, légitimité des lois et des politiques. Comme pour d’autres questions, telles que celle de « l’identité » par exemple, la question de la légitimité semble avoir été portée par une nouvelle conscience populaire, surgissant du silence des décennies passées, émergeant du brouillard produit par la dépolitisation, la méconnaissance de l’histoire, le grave endommagement sinon la rupture des canaux de la transmission de l’expérience historique dans toutes ses dimensions. C’est comme si la conscience politique des Algériens s’était formée au cours du temps, goutte à goutte, comme une eau souterraine, à l’insu de tous, du pouvoir bien sûr, mais également de la société elle-même, de la société en tant qu’entité collective, vivante, consciente d’être une société en tant que telle. Cet état de la conscience d’elle-même par la société algérienne des dernières décennies, s’explique par la nature des forces qui se sont exercées sur elle, l’empêchant en l’occurrence de former les instruments et les institutions de l’expression et de la représentation de soi. En effet, sans la liberté, réelle, effective, assumée, de penser, de s’exprimer, d’être reconnu et de se reconnaître soi-même, la société ne peut exister véritablement. Force est de constater aujourd’hui que le mouvement populaire est l’expression concentrée de cette dynamique autonome de la société algérienne, dynamique nourrie par les marges, par une multitudes de refus individuels ou collectifs, de rebellions ponctuelles, de démarches alternatives, parfois obliques, souvent avortées. Avant la révolution de février, la connexion ne s’était pas faite entre ces différents éléments d’une conscience éclatée de soi, ces différentes manifestations du malaise et parfois, trop souvent, du désespoir extrême, une conscience incohérente, paradoxale, tourmentée, mais qui s’est finalement cristallisée et orientée vers le cours actuel de l’événement historique que nous vivons depuis bientôt une année. Dans ce contexte, le besoin de légitimité apparaît comme le ciment de la revendication populaire. Le mouvement populaire identifie, à juste titre, le régime comme la cause des problèmes que connaît le pays, et donc considère que leur solution passe par le départ de celui-ci. Totalement. Car il n’est en aucune façon réformable. Et, en effet, lorsqu’un régime en arrive à être soumis à la logique suprême de la corruption dans tous les domaines, la seule perspective qui s’offre aux citoyens désireux de défendre le bien public et l’intérêt général, est le changement radical, au sens de la nécessité vitale d’extirper le mal à sa racine. C’est de ce point de vue qu’il faut entendre le slogan « Yetnahaw gaa », « qu’ils s’en aillent tous », ou, autrement dit, « que soient extirpées toutes les racines du régime ». La racine du mal, étant la nature même du régime, c’est donc par rapport à la question de sa légitimité que s’organise la revendication fondamentale du mouvement populaire. De ce point de vue, par la remise en cause du régime illégitime établi par la force à l’indépendance, la révolution de février établit le lien pertinent de sa filiation avec la révolution de novembre, et inscrit son combat pour la souveraineté populaire comme continuité et accomplissement de la souveraineté nationale conquise par les Algériens en 1962.
4. Dans ce contexte, qu’est-ce que Nous autres ? La publication de la série de livres « Nous autres, éléments pour un manifeste de l’Algérie heureuse » a commencé en 2016. Il s’agissait pour moi de rassembler dans des ouvrages collectifs, autour de certains thèmes, des Algériennes et des Algériennes (mais pas uniquement) d’horizons différents, pensant différemment les uns des autres, mais fondamentalement animés par leur foi en des valeurs communes, les valeurs de liberté, de justice et de dignité notamment. L’objectif central de ces livres était/est de permettre de développer la Connaissance, et en particulier, des questions universelles qui traversent la société algérienne, comme d’autres sociétés, à notre époque. Cette volonté de Connaissance et de partage de celle-ci répond à une soif profonde de connaître notre histoire, notre monde, notre société. Elle répond aussi directement à une demande de transmission de l’expérience de nos générations par les générations plus jeunes. La société souffre énormément d’une insuffisance de repères, les repères historiques, culturels, politiques ou idéologiques que donnent normalement l’école, les institutions, les médias, dans un contexte de liberté (toujours relative), de débat et de confrontation politique ou intellectuelle. Or chez nous, la connaissance de l’histoire a été interdite et la liberté de pensée et d’expression restreinte, contrainte et contrôlée au point de la rendre socialement insignifiante. Au point qu’aujourd’hui, près de 60 ans après l’indépendance du pays, les Algériens ne disposent pas d’un roman national. Notre parti-pris est que la société doit s’efforcer de forger par elle-même les instruments intellectuels, idéologiques ou politiques de sa libération et de son développement, de façon humble, patiente et déterminée. Nous estimons que cela passe par l’effort individuel et collectif, l’exercice de la raison et de la liberté, le retour de la confiance en soi, le respect de soi, et des autres. « Nous autres » ne désigne pas un groupe particulier d’individus, une nationalité, une ligne politique, une philosophie constituée, mais tout au plus, une attitude. L’attitude de femmes et d’hommes qui ont foi dans les valeurs de dignité, de justice, de liberté, qui ont foi dans la pensée, dans le travail, dans la lutte et dans l’amour.