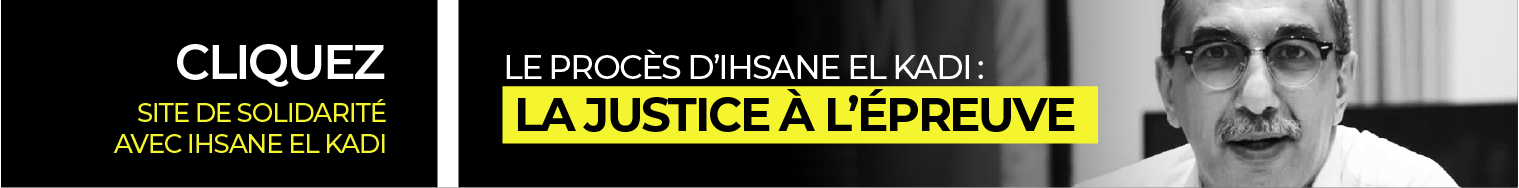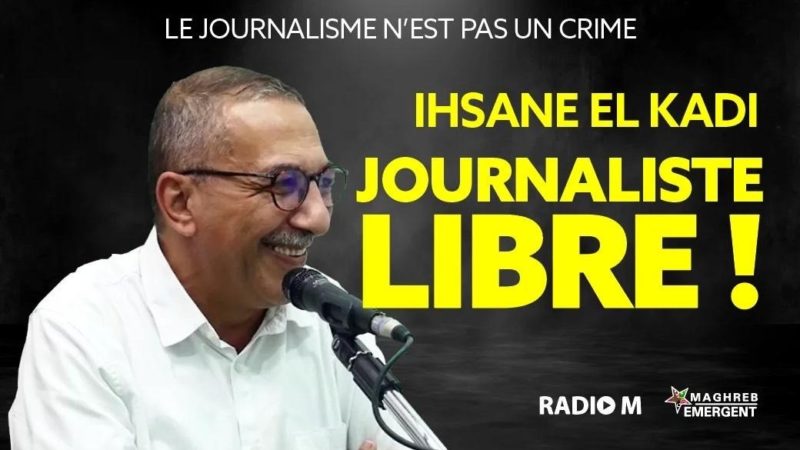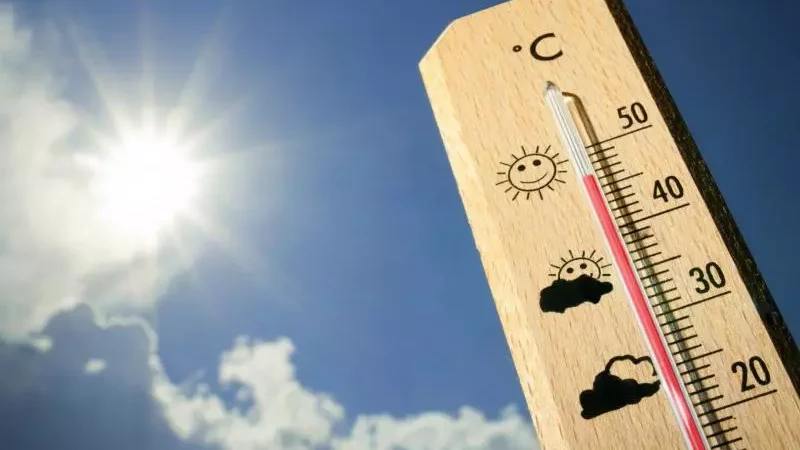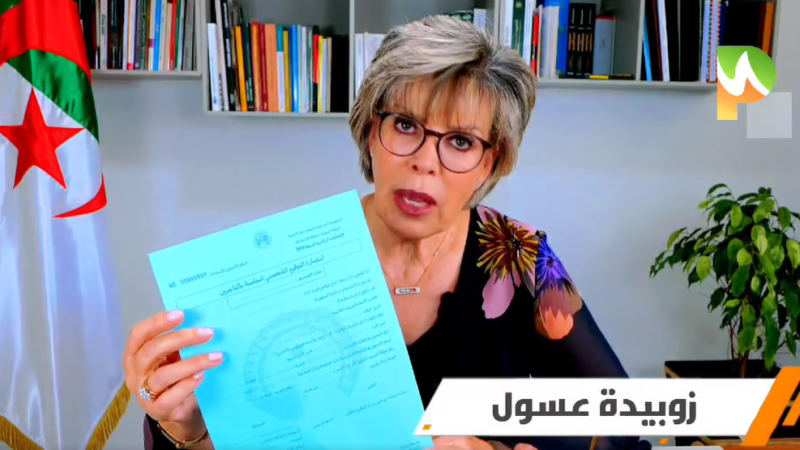Abdelmadjid Tebboune, est élu président avec 58,15% de voix et avec le taux de participation officiel le plus bas de l’histoire de moins de 40%. Le niveau record de l’abstention confirme que le scrutin du 12 décembre est loin de répondre à l’Algérie entrée en rébellion contre le régime et qui accomplit, aujourd’hui, son 43ème vendredi du hirak populaire.
Cette élection, contestée et boudée, ne règle rien, mis à part, aux yeux du régime, de boucher le “trou” de la présidence. Les analystes peuvent plancher sur la “surprise” d’un Bengrina arrivé second avec 17,38%, la nouvelle bérézina de Ali Benflis (10,55%) ou sur la déconfiture de Azzedine Mihoubi, devenu subitement le “favori” et qui ne recueille que 7,26%. Abdelaziz Belaïd est le seul qui est à la place prévue, dernier, avec 6,66%
Mais indéniablement si le régime peut se satisfaire d’avoir mis fin au “vide institutionnel”, rien n’est réglé dans la crise politique. Non seulement le taux de participation officiel est bas (, 39,93%) mais sur les 8,5 millions de suffrages exprimés on enregistre plus de 1,24 millions de suffrages annulés. C’est significatif.
Les chiffres officiels de la participation sont toujours pris – et on peut aisément le comprendre- avec beaucoup de circonspection par les analystes. Parfois, la main invisible est grossière – ce fut le cas par exemple lors des législatives de 1997 -, dans d’autres, les chiffres, même gonflés, essayent de ne pas être trop criards par rapport à ce qui se passe dans la réalité.
Avec un taux officiel final participation de 39,93% annoncé par le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Mohamed Charfi, on entre dans la seconde catégorie. Certains pourraient estimer que le taux de participation à l’étranger – 8,69%- le plus bas de tous les temps, exprime beaucoup mieux le rejet de l’élection que celui annoncé au niveau national, 41,14%.
L’échec des campagnes sur le thème de la main de l’étranger
Il reste que le taux global de 39,93% – c’est le plus bas chiffre annoncé officiellement, de toutes les élections présidentielles organisées en Algérie – est en soi une reconnaissance de l’ampleur de la défiance des Algériens à l’égard de l’offre politique du système.
Ni la dramatisation de la résolution, non contraignante, du parlement européen sur le thème de l’ingérence étrangère, ni les tentatives de créer des dissensions au sein de la société autour de l’emblème amazigh – des juges ont refusé d’entériner l’accusation politique d’atteinte à l’unité nationale à ce sujet -, ni les campagnes orchestrées autour d’un hirak supposément manipulé par les mains étrangères – que des intellectuels organiques du pouvoir parfois installés en Occident depuis des décennies ont honteusement œuvré à faire passer – n’ont eu d’effet.
Les thèmes de la peur, des accusations en traîtrise, des « mains étrangères » n’ont pas provoqué de rush vers les urnes. Le vote de l’émigration, dont les images ont été dans le passé utilisées pour faire la promotion des élections dans le pays, est éloquent. Le rejet est écrasant avec un taux très bas, qui est bien dans l’esprit du hirak. Le taux officiel de moins de 40% – même si des doutes s’expriment déjà sur sa véracité – est un aveu contraint que la majorité des Algériens ne se sent pas concernée par l’offre politique du régime.
Si le régime voulait faire de ce 12 décembre 2019 le moment de la fin du “Hirak”, c’est un véritable échec. Toutes les raisons qui ont poussé les Algériens dans la rue sont encore présentes et même aggravées par la répression, l’instrumentalisation de la justice et le grossier alignement des médias audiovisuels publics et privés.
Aucun de ces leviers – répression, propagande, manipulation autour de l’amazighité pourtant inscrite dans la constitution, chose que certains juges ont courageusement rappelé – n’a fonctionné.
Le Hirak va continuer
Les Algériens ne sont pas contentés de bouder les urnes. Ils ont réalisé, en manifestant massivement à Alger et aussi dans d’autres villes du pays, un véritable “boycott actif”. On se souvient que ce mot d’ordre de “boycott actif” lancé par l’opposition dans le passé n’a jamais pu avoir de traduction concrète en raison du désintérêt des Algériens pour le jeu politique.
Or, depuis le 22 février, c’est une société, à la politisation beaucoup plus affirmée qu’on ne le croyait – même si le défaut d’organisation est réel- qui s’exprime dans la rue. Et qui contrairement aux hommes politiques hésitants n’hésite pas à exiger la fin de la règle qui est au cœur du système depuis l’indépendance: la cooptation des présidents.
Pour cette Algérie nouvelle qui émerge avec le 22 février 2019, l’élection d’hier est une élection du passé, celle que le régime organise pour la forme, comme une formalité. En reconnaissant un taux d’abstention élevé, le régime ne l’avoue qu’à demi. Mais pour ceux qui sortent dans la rue avec un pacifisme remarqué le 12 décembre ne change pas la donne. Le combat pour la démocratie, l’Etat de droit, la justice indépendante se poursuit. Le retour au 21 février n’est pas à l’ordre du jour. Le Hirak va se poursuivre même s’il va devoir s’adapter à cette nouvelle “réalité” du régime